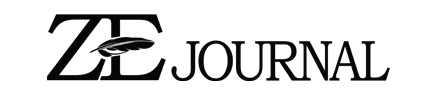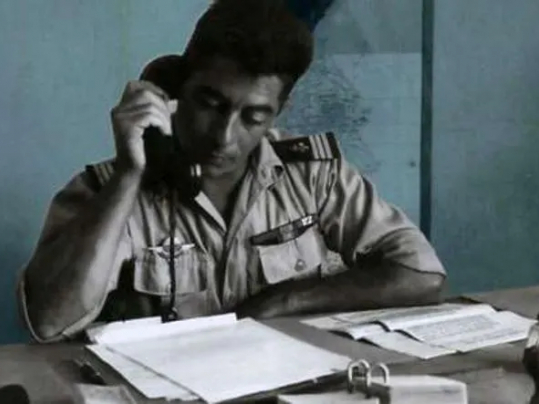Erreurs d’interprétation sur l’évolution des États-Unis (2/2) par Thierry Meyssan

Poursuivant notre analyse des erreurs d’interprétation des actions de l’administration Trump, nous revenons sur la fermeture de nombreuses agences fédérales, sur la raison pour laquelle elle envisage de déporter les Palestiniens, et sur son approche de la guerre en Ukraine.
En 1838, 4 à 8 000 Cherokesse sont morts de froid, de faim ou d’épuisement, sur la « piste des larmes ». En application de l’Indian Removal Act, signé par le président Andrew Jackson, ils laissaient la côte Est des États-Unis aux Européens et acceptaient de se rendre au sud du fleuve Mississippi. Cependant, c’est aujourd’hui la seule tribu indienne a avoir réussi à maintenir son mode de vie sans être éradiquée par les Européens. Cette déportation est l’exemple suivi par Donald Trump pour mettre fin au nettoyage ethnique de la Palestine et résoudre le conflit israélo-palestinien qui s’éternise depuis 80 ans.
Le retour du sudisme
Les États-Unis ont été à la fois sudistes et fédéralistes. Les sudistes ayant été vaincus à la fin de la guerre de Sécession, leurs vainqueurs ont imposé le mythe selon lequel cette guerre aurait opposé les esclavagistes aux abolitionnistes. En réalité, au début de la guerre, les deux camps étaient esclavagistes et, à la fin, ils étaient tous les deux abolitionnistes. Le vrai sujet du conflit était de savoir si les douanes ressortaient des compétences des États fédérés ou de l’État fédéral.
Les Jacksoniens, précurseurs des sudistes, souhaitaient un « État fédéral minimum ». Ils ont ainsi renvoyé aux États fédérés de nombreuses compétences. C’est ce qu’a fait Donald Trump lors de son premier mandat lorsqu’il a soutenu le renvoi de la question de l’avortement de l’État fédéral aux États fédérés. À titre personnel, il ne semble pas avoir d’opinion tranchée sur ce sujet. Sa rivale, Kamala Harris, a eu tort, en tant que woke, de le présenter comme un réactionnaire alors que la moitié des États fédérés respectent les droits des femmes et autorisent l’interruption volontaire de grossesse (IVG). C’est l’une des principales causes de son échec.
Lorsque Donald Trump a annoncé la création d’un Department of Government Efficiency (Département de l’efficacité gouvernementale - DOGE), il entendait casser une administration fédérale décidant depuis Washington comment chaque citoyen devait vivre même à 2 500 kilomètres de là. Certes, il en a confié la responsabilité à un libertarien, Elon Musk, mais il ne s’agit pas pour lui de dégraisser l’État fédéral par libéralisme reaganien. Il va dissoudre des milliers d’agences gouvernementales, non pas parce qu’elles coûtent cher, mais parce qu’elles sont, à ses yeux, illégitimes.
Par certains égards, le débat entre sudistes et nordistes, entre confédéralistes et fédéralistes, rappelle celui des girondins et des montagnards durant la révolution française. Toutefois, aux États-Unis, les États fédérés n’avaient qu’une courte histoire, tandis qu’en France, les régions avaient un millénaire d’histoire féodale : rendre le pouvoir aux provinces a toujours été suspect pour Paris de réhabiliter la féodalité.
L’expansionnisme états-unien
Les États-Unis, qui ne rassemblaient que 13 États fédérés au moment de leur création, en comptent désormais 50, plus 1 district fédéral et 6 territoires. D’un point de vue états-unien (là encore, cela n’a aucun rapport avec Donald Trump), ils n’ont pas terminé leur croissance. Depuis les années 30, ils aspirent à absorber tout le plateau continental nord-américain, incluant le Canada, le Groenland, l’Islande et l’Irlande, ainsi que le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua, le Costa-Rica et le Panama, sans oublier la totalité des Caraïbes [1].
Dans cet état d’esprit national, Donald Trump a annoncé lors de son discours d’investiture que son pays dénommerait désormais le golfe du Mexique, « golfe d’Amérique », ce qu’il a décrété quelques heures plus tard. Outre que les États-uniens ne se considèrent pas comme tels, mais comme « Américains », ce mot fait référence non pas à une dénomination locale, mais au colonisateur Amerigo Vespucci.
Il n’a pas annoncé d’annexion du Canada, du Groenland et du canal de Panama, comme il l’avait évoqué préalablement, mais la colonisation de la planète Mars.
Cependant, contrairement aux commentaires de la presse européenne, Donald Trump n’a jamais parlé de conquérir le plateau continental nord-américain par la force militaire, même s’il a évoqué le développement de bases militaires au Groenland. En tant que jacksonien, il tient à acheter ces territoires. Il semble qu’il « négocie » actuellement, de manière particulièrement agressive, avec le Danemark la cession du Groenland en échange d’un engagement de défense.
Notez bien que l’administration Trump persiste à menacer Cuba, vis-à-vis duquel il a une ambition coloniale, mais pas le Venezuela, qui se trouve hors du plateau continental nord-américain. Pourtant, elle désigne ces deux États comme « communistes » et prétend les traiter de la même manière.
Compte tenu de la proximité idéologique entre les deux « peuples élus », l’administration Trump aborde la question d’Israël comme si les Palestiniens étaient des Indiens attaquant des diligences. Le président Andrew Jackson avait décidé de mettre fin aux guerres indiennes en négociant des traités avec les différentes tribus. Très peu ont été appliqués, mais sa grande « réussite » fut avec les Cherokees. Il les déporta au sud du Mississippi. Il se trouve que, malgré l’épisode sanglant de « la piste des larmes », les Cherokees furent les seuls Indiens à respecter ces accords. Et aujourd’hui, ils sont la seule tribu à avoir survécu avec sa culture. Ils gèrent ensemble un empire de casinos. Mais l’application de la même méthode avec les Palestiniens ne peut pas fonctionner : les Cherokees ne se pensent pas propriétaires de la « Terre-Mère », ils peuvent rester Cherokees où qu’ils se trouvent. Les Palestiniens, au contraire, sont attachés à leur Terre et savent qu’ils mourront, en tant que culture, s’ils la perdent.
La substitution du commerce à la guerre
Dernier point important pour les jacksoniens : la substitution du commerce à la guerre. Donald Trump pense que la plupart des guerres sont des massacres inutiles. Elles ne sont qu’un moyen de manipuler les masses pour atteindre des objectifs inavouables. Comme, en définitive, il ne s’agit souvent que de questions d’argent, il faut substituer le commerce aux guerres.
Cette doctrine fonctionne très bien dans la plupart des cas, cependant certaines guerres ont des motifs complexes sans rapport avec des objectifs commerciaux. Dans ces cas et dans ceux-là seuls, le jacksonisme ne fonctionne pas.
C’est par exemple la guerre en Ukraine. Si l’on prétend que la Russie souhaite annexer son voisin, on peut négocier avec lui de quoi satisfaire son appétit sans porter atteinte à l’intégrité de ce pays. Mais si l’on pense que Moscou souhaite sincèrement terminer la « Grande Guerre patriotique » (la Seconde Guerre mondiale), vaincre les nazis et les nationalistes intégraux (les « bandéristes »), alors aucune négociation commerciale ne pourra l’arrêter.
C’est le talon d’Achille de l’Administration Trump : la guerre en Ukraine n’a pas de mobile économique, contrairement à ce qu’ont affirmé les hommes politiques occidentaux. Moscou est sérieux lorsqu’il exige de dénazifier l’Ukraine. Sur ce point, les États-Unis devront plier ou s’affronter durement à lui.
S’ils cèdent, un second problème se posera : la Russie est un territoire immense dont personne peut assurer la défense des frontières (plus de 20 000 kilomètres). Moscou exige donc traditionnellement que ses voisins belliqueux soient neutres. C’est le sens du malentendu sur l’OTAN : la Russie reconnaît, par la déclaration d’Istanbul (2003), le droit de chaque pays à adhérer à une coalition militaire, mais elle refuse que cette adhésion ouvre la voie à un stockage d’armes de pays tiers sur son sol. Or, durant la présidence de Boris Elstine, les États-Unis, maintes fois alertés, ont poursuivi leur forcing pour inclure les différents États post-soviétiques à adhérer à l’OTAN, sauf la Russie, qui le leur demandait pourtant.
Les jacksoniens n’ont aucune raison de poursuivre l’élargissement de l’OTAN, mais y renoncer supposerait qu’ils abandonnent la politique expansionniste des partis républicain et démocrate pour se concentrer sur la leur : celle du plateau nord-américain.
Pour Donald Trump, il ne fait aucun doute que les États-Unis n’ont aucune raison de s’impliquer dans le conflit ukrainien. Il se propose de faire taire les armes en cessant de subventionner le régime corrompu de Kiev. Là encore, l’Union européenne interprète ce retrait comme une invitation à prendre le relai. C’est encore une faute : l’UE n’existe que par la volonté de Washington, en s’impliquant en Ukraine sans que la nouvelle administration US le lui demande, l’UE ne fera que hâter sa dissolution.
Concernant la guerre commerciale, les non-États-uniens ont été choqués par la manière dont le président Donald Trump envisage les droits de douane. Ils pensent que ceux-ci n’ont de sens que pour protéger des secteurs économiques, tandis que les jacksoniens pensent qu’ils peuvent aussi être utilisés comme armes politique.
Donald Trump a par exemple, durant quelques heures, augmenté les droits de douane des produits colombiens pour les placer à 25 %, en outre il a menacé de passer la semaine suivante à 50 % si Bogota persistait à s’opposer au rapatriement de ses ressortissants. Ils ont été levés dès que Bogota a rapatrié lui-même ses ressortissants illégaux.
La même chose se reproduit avec le Canada et le Mexique (15 %), et avec la Chine (10 %). L’administration Trump, là encore n’a aucun argument économique, mais en a un politique. Elle considère que la Chine fournit des précurseurs chimiques aux cartels de la drogue et que le Mexique et le Canada laissent entrer ces drogues aux États-Unis.
Concernant l’Union européenne, c’est tout autre chose. L’administration Trump entend rééquilibrer sa balance commerciale. Elle pourrait édicter des droits de douane de 10 %, mais sur certains produits seulement. Il s’agit là d’un traitement conventionnel de ces droits même si l’on comprend mal comment il s’accorde avec les engagements pris en adhérant à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).
Cet article fait suite à « Erreurs d’interprétation sur l’évolution des États-Unis (1/2) », par Thierry Meyssan, 28 janvier 2025.
Note:
[1] « Trump et Musk, le Canada, le Panama et le Groenland, une vieille histoire », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 14 janvier 2025.
- Source : Réseau Voltaire