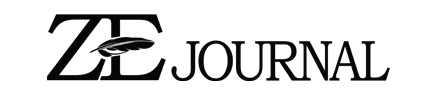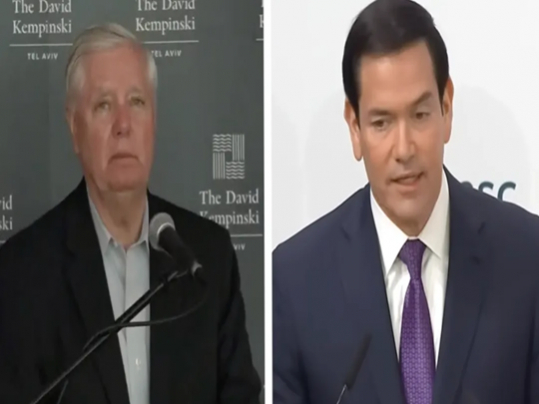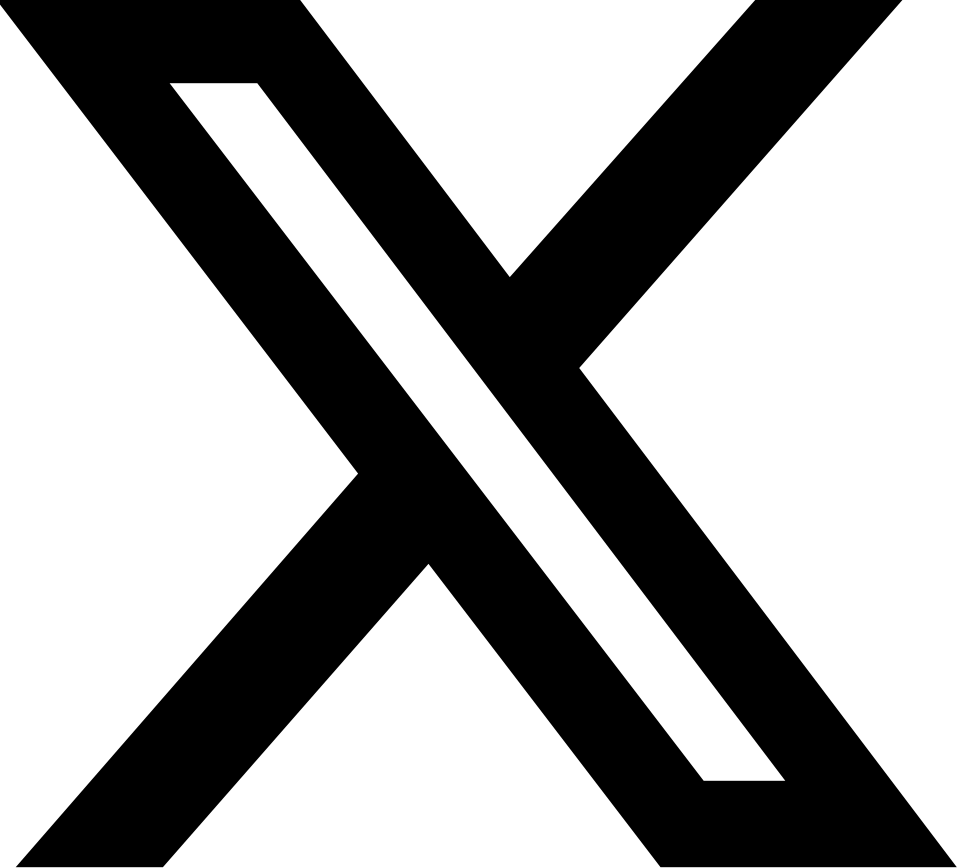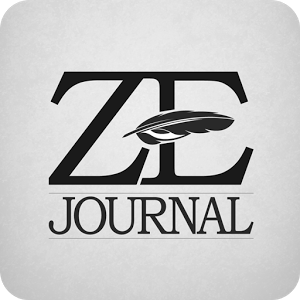Le rôle des pays arabes dans la normalisation de l’impunité et de la domination d’Israël

L’opération « Déluge d’Al-Aqsa » du 7 octobre 2023 visait à relancer la résistance armée palestinienne et à réaffirmer la cause palestinienne dans la conscience arabe et mondiale après des années de marginalisation.
Elle a porté un coup dur à la dissuasion israélienne, brisant son image de solide avant-poste colonial capable de protéger les intérêts stratégiques occidentaux.
Elle a également mis en évidence les failles de son contrat social militarisé, qui repose sur la capacité du régime à protéger sa population de colons.
Si l’opération a imposé de nouvelles réalités politiques au régime israélien, elle a aussi eu un coût humain considérable pour les Palestiniens : l’attaque génocidaire d’Israël contre Gaza a déclenché l’une des pires crises humanitaires de l’histoire récente.
Pourtant, la vague de solidarité arabe qui aurait dû accompagner l’opération ne s’est pas matérialisée et ne s’est pas traduite par des changements politiques concrets. Au contraire, les évènements ont mis à nu les liens étroits entre les régimes arabes et le projet colonial israélien, qui s’enracinent dans des intérêts mutuels, la préservation de leurs régimes et une hostilité commune envers la résistance palestinienne.
Cet article soutient que ces liens, entretenus par la répression et la coopération stratégique et économique, et renforcés par la complicité occidentale, ont permis tout à la fois au régime israélien d’échapper à l’isolement et d’intensifier son expansion coloniale et sa domination régionale.
Collusion, contrainte et capitulation arabes
L’un des aspects les plus frappants des politiques des régimes arabes qui ont enhardi Israël est l’accélération de la normalisation des relations.
L’expansion de la normalisation reflète le paysage post-révolutions arabes, dans lequel les forces contre-révolutionnaires ont consolidé leur pouvoir autocratique et les régimes alignés sur les États-Unis ont donné la priorité à leur survie et à leurs intérêts propres plutôt qu’à la solidarité régionale et aux droits des Palestiniens.
Dans un contexte d’effondrement économique, de répression et de guerres civiles, la Palestine, tout en suscitant toujours une forte émotion, a été de plus en plus mise de côté par des sociétés fracturées et des alliances stratégiques changeantes.
Ce réalignement régional plus large a ouvert la voie aux accords d’Abraham, lancés en 2020, qui ont remarquablement résisté malgré les atrocités de masse que continue de perpétrer Israël.
Les Émirats arabes unis et les autres signataires ont donné la priorité à la coopération stratégique avec le régime israélien, alors même que le génocide continue de décimer les Palestiniens.
Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a profité de cet environnement permissif pour intensifier ses campagnes militaires et accélérer la consolidation territoriale, conformément à son objectif déclaré de « changer radicalement le visage du Moyen-Orient ».
Le cadre de normalisation a non seulement consolidé la domination régionale d’Israël, mais lui a également permis d’escalader la violence à Gaza, en Iran et en Syrie en toute impunité.
Les accords d’Abraham et l’impunité israélienne
Les accords d’Abraham ont intégré Israël et plusieurs régimes arabes dans une architecture sécuritaire et économique dirigée par les États-Unis, ancrant le projet colonial israélien au cœur de la politique régionale. Présentés comme des « accords de paix », il s’agit en réalité d’accords utilitaires qui privilégient le profit et la géopolitique militarisée au détriment de la justice et de la libération, accordant à Israël une impunité quasi totale.
Il est frappant de constater que pendant sa campagne génocidaire à Gaza, le commerce entre les signataires des accords et Tel-Aviv a augmenté de 24 %, atteignant 10 milliards de dollars, alors même que le commerce mondial d’Israël a diminué de 14 %. Sans surprise, Israël en est sorti comme le principal bénéficiaire.
Les accords ont précipité trois changements structurels qui ont des implications profondes pour la dynamique régionale et les perspectives de libération des Palestiniens :
- Érosion du poids diplomatique palestinien :Les accords ont brisé le fragile consensus arabe qui liait autrefois la normalisation à la reconnaissance de l’État palestinien, ce qui a permis à Israël de consolider ses relations diplomatiques et économiques tout en poursuivant son occupation et l’expansion de ses colonies sans être entravé par une résistance arabe unifiée.
- Remodelage de la conscience politique arabe :Les accords ont ancré une acceptation fataliste de la domination israélienne, remplaçant l’action collective arabe par une logique d’accommodement. L’opposition à la normalisation, autrefois enracinée dans la solidarité et l’autodétermination palestinienne, est désormais rejetée comme étant irréaliste ou nuisible à la poursuite égoïste de la « paix et de la prospérité » par les régimes autocratiques.
- Réorientation de la perception régionale des menaces :Les accords ont transformé Israël, qui était une source d’instabilité, en un partenaire central en matière de sécurité, l’alignant sur les États arabes et les États-Unis dans une alliance régionale visant à contrer l’Iran et les mouvements de résistance, détournant ainsi l’attention de la Palestine et de la colonisation sioniste en cours.Dans le même temps, la société civile arabe, autrefois au cœur de la solidarité régionale, a été affaiblie par la répression. De plus, la désillusion face aux résultats des soulèvements passés a tempéré l’appétit pour les mobilisation collective.
Si le 7 octobre a suscité un regain d’engagement public – allant des boycotts aux efforts d’aideet aux manifestations contre la normalisation –, cet élan ne s’est pas encore traduit par une pression suffisante pour entraîner des changements politiques significatifs au niveau gouvernemental.
Dans ce contexte, le 7 octobre a mis en évidence un profond fossé entre la résurgence de la résistance palestinienne et une région politiquement stagnante, soumise à la normalisation, à la sécurisation et aux politiques contre-révolutionnaires.
L’alignement des régimes arabes sur les objectifs israéliens a permis à Israël de mener une campagne génocidaire à Gaza en toute impunité, tout en créant une ouverture stratégique pour étendre son influence régionale et ses conquêtes agressives.
L’axe de la résistance et la guerre contre l’Iran
L’axe de la résistance, une alliance régionale dirigée par l’Iran et comprenant le Hezbollah au Liban, divers groupes armés irakiens, le Hamas et le Jihad islamique en Palestine, et Ansarullah au Yémen, se positionne depuis longtemps comme une force opposée à la campagne génocidaire d’Israël à Gaza et à son agression régionale plus large.
Il a fourni un soutien financier et militaire aux factions palestiniennes et a soutenu la résistance armée de Gaza pendant des décennies, en particulier après le 7 octobre.
Grâce à une guerre asymétrique et à des opérations coordonnées sur plusieurs fronts, l’Axe a remis en cause la supériorité militaire conventionnelle d’Israël, mis en évidence les faiblesses de sa position régionale et lui a infligé des coûts humains et économiques considérables.
Avant sa dernière agression contre l’Iran, le régime israélien avait poursuivi une stratégie visant à isoler et à cibler individuellement chaque composante de l’Axe.
Il a dévasté le Hamas à Gaza en massacrant la population et affaibli le Hezbollah en assassinant ses principaux dirigeants, dont Sayyed Hassan Nasrallah, et en ciblant la base sociale du groupe.
Au Yémen, il a frappé des ports et des infrastructures critiques avec le soutien des États-Unis.
Parallèlement, Israël a intensifié ses opérations secrètes visant le personnel et les actifs iraniens tout en plaidant en faveur d’une action militaire américaine contre les infrastructures nucléaires iraniennes.
Cette escalade a culminé avec l’agression directe d’Israël sur le territoire iranien, qui ne peut être dissociée de l’architecture géopolitique plus large de l’impunité qui stimule la violence israélienne.
La guerre contre l’Iran constitue un changement qualitatif vers une confrontation entre États, la première du genre depuis la guerre de 1973, visant à modifier la dynamique du pouvoir régional en faveur de l’objectif israélien de s’assurer une domination régionale incontestée.
Elle sert également à détourner l’attention de la campagne génocidaire menée actuellement par Israël à Gaza. Les réactions largement modérées, voire tacitement ou ouvertement approbatrices dans certains cas, des régimes arabes révèlent la convergence stratégique bien établie avec les impératifs régionaux d’Israël et des États-Unis.
La nouvelle Syrie et l’avancée coloniale d’Israël
Avant la guerre de douze jours menée par Israël contre l’Iran, l’Axe de la résistance était déjà affaibli par des tensions internes, notamment la faillite morale et politique du régime d’Assad.
La Syrie de Bachar al-Assad n’avait pas d’engagement idéologique envers l’Axe, car elle donnait la priorité à la survie du régime. Cette approche opportuniste est devenue flagrante dans le rapprochement d’Assad avec les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite avant l’effondrement, un tournant stratégique largement interprété comme une tentative de se distancier de l’Axe.
En outre, si la position géographique de la Syrie la rendait indispensable à l’Axe en reliant l’Iran au Liban et en servant de voie d’acheminement pour les armes, la répression brutale de la population par Assad a compliqué ce rôle.
Les médias grand public ont amplifié le cadre sectaire de la guerre civile syrienne postérieure à 2011, présentant la Syrie comme un « régime dirigé par les alaouites » réprimant violemment une « majorité sunnite ».
Ce discours a gagné du terrain dans le monde arabe, où les tensions sectaires existantes ont permis aux opposants à l’Axe de le présenter non pas comme un front légitime de résistance anti-israélienne, mais comme un vecteur de domination chiite dirigée par l’Iran.
En présentant l’Axe comme répressif et expansionniste, certains régimes arabes ont justifié la normalisation avec Israël comme un moindre mal. Ce changement de discours a érodé la légitimité morale de l’Axe et normalisé des réalignements régionaux autrefois tabous.
L’effondrement du régime d’Assad en décembre 2024 a porté un coup dur à l’Axe. Pendant plus d’une décennie, malgré les frappes israéliennes incessantes sur les positions iraniennes et du Hezbollah en Syrie, Assad avait maintenu un accord tacite avec le régime israélien, dans lequel il tolérait les frappes qui épargnaient les infrastructures du régime.
Sa chute a brisé cet accord, exposant l’Axe à des vulnérabilités logistiques et stratégiques. Et le nouveau régime installé en Syrie a permis à Israël de mener l’incursion militaire la plus expansive et la plus facile depuis des décennies, atteignant des niveaux de pénétration territoriale et stratégique auparavant jugés impensables.
Sous couvert de pragmatisme, les nouveaux dirigeants de Damas ont à plusieurs reprises affirmé qu’ils ne s’opposeraient pas à Israël et se sont s’engagé explicitement à empêcher que le territoire syrien soit utilisé à des opérations de résistance ou à des transferts d’armes vers des mouvements anti-israéliens.
Cette posture immédiate de capitulation a offert à Israël une rare opportunité stratégique pour intensifier sa campagne militaire agressive sur le territoire syrien en toute impunité.
Alors que le régime syrien se concentre sur la consolidation de son contrôle interne et l’obtention d’une légitimité internationale, Israël a rapidement démantelé ce qui restait de l’infrastructure militaire syrienne.
Plus alarmant encore, Israël a étendu son contrôle territorial de facto bien au-delà du plateau du Golan occupé, s’étendant sur de vastes zones du sud et de l’est de la Syrie. L’incursion d’Israël en Syrie, menée avec une résistance minimale, représente l’une des phases les plus fluides et incontestées de son expansion coloniale depuis la Nakba de 1948.
Cependant, ce qui semblait au départ n’être que de timides condamnations de l’agression israélienne par le nouveau régime syrien a depuis révélé une réalité bien plus inquiétante.
Des rapports récents ont dévoilé des réunions entre des responsables israéliens et syriens laissant entrevoir la possibilité d’une normalisation.
Cette ouverture diplomatique est particulièrement alarmante compte tenu du programme expansionniste ouvertement affiché d’Israël, qui table sur la faiblesse et la dépendance de la Syrie pour faire avancer son projet colonialiste.
Plus inquiétant encore, les responsables israéliens ont publiquement préconisé d’exploiter les fractures sectaires de la Syrie dans le cadre d’une stratégie délibérée visant à fragmenter le pays en enclaves sectaires semi-autonomes.
Cette approche consistant à diviser pour mieux régner sert les intérêts à long terme d’Israël, qui souhaite maintenir l’instabilité régionale et empêcher la réémergence d’un État syrien unifié.
Pour aggraver ces préoccupations, les forces de sécurité syriennes ont arrêté des dirigeants palestiniens et semblent disposées à démanteler les principales factions et groupes de résistance.
Ce faisant, elles ont effectivement abandonné une cause qui, depuis la formation de la Syrie postcoloniale, était au cœur de l’identité nationale et de la sécurité du pays.
Ce changement d’orientation politique marque une triste rupture avec les principes qui définissaient autrefois le rôle régional de la Syrie ; c’est le signe d’une acceptation plus large du projet colonial expansionniste d’Israël qui s’étend désormais au cœur d’un Levant fracturé.
Un édifice bâti sur du sable
La tentative actuelle d’Israël de dominer la région est une histoire d’agression génocidaire, de subordination des États arabes par le biais d’une rapprochement diplomatique et d’exploitation des divisions régionales.
Cette domination, soutenue par le soutien inconditionnel des États-Unis et le soutien tacite de nombreux régimes arabes, projette une image d’invincibilité qui masque des vulnérabilités fondamentales.
Son influence régionale repose sur deux fondements principaux : une capacité militaire écrasante soutenue par l’aide militaire américaine et des accords de normalisation diplomatique qui contournent les droits et les aspirations des Palestiniens.
Cette force à court terme entrainera toutefois une fragilité à long terme. La dépendance d’Israël à l’égard d’un soutien extérieur lie son destin aux caprices de la politique des États-Unis qui, avec l’évolution des priorités dans un ordre mondial en mutation, pourraient finir par diminuer leur soutien et leur aide.
De fait, une transformation démographique importante est en cours aux États-Unis, les sondages d’opinion montrant que plus de la moitié des Américains ont désormais une opinion défavorable d’Israël, ce qui constitue un revirement spectaculaire par rapport à des décennies de soutien public quasi inconditionnel.
De plus, la normalisation croissante entre les régimes arabes et Israël masque une profonde instabilité sous-jacente qui menace de briser l’illusion de la stabilité régionale.
Malgré les alignements officiels et la répression étatique, l’opinion publique arabe reste fermement attachée à la cause palestinienne.
Dans le même temps, les populations de la région continuent de considérer Israël comme une entité coloniale étrangère dont les ambitions s’étendent bien au-delà de la Palestine.
Les régimes qui s’alignent sur Israël risquent de provoquer des réactions négatives au niveau national, en particulier dans un contexte de crises économiques croissantes et d’évolution de l’ordre mondial qui alimentent un mécontentement généralisé. Les tensions entre les États arabes et leurs sociétés se conjuguent à l’instabilité régionale et la récente guerre avec l’Iran complique encore davantage la quête israélienne d’une domination incontestée.
En fait, le président américain Donald Trump a négocié le cessez-le-feu avec l’Iran avant qu’Israël ne puisse atteindre ses objectifs stratégiques.
En conséquence, le régime iranien est sorti vainqueur après avoir résisté à la pression militaire combinée d’Israël et des États-Unis.
Plus important encore, il a démontré une formidable capacité de riposte, infligeant de graves dommages à d’importants sites militaires et stratégiques israéliens et exposant les vulnérabilités de ses systèmes de défense antimissile.
Ce résultat, susceptible d’avoir des répercussions dans toute la région et de constituer un obstacle majeur à la quête d’une domination incontestée par Israël, offre une leçon stratégique sur les limites de sa suprématie militaire.
Comment aller de l’avant
Si l’affaiblissement de l’axe de la résistance pose des défis, il a également ouvert la voie à de nouvelles formes de résistance, ancrées dans la détermination palestinienne (sumud) et la solidarité mondiale, pour contrer la domination régionale d’Israël.
Les interventions croissantes d’Israël au Liban, en Syrie, au Yémen et en Iran risquent de le mener à la surenchère, mettant à rude épreuve sa capacité à maintenir son contrôle.
L’histoire montre que les efforts de résistance renaissent souvent sous des formes plus résistantes, alimentées par l’oppression même que perpétue Israël.
Cela suggère que la posture agressive du régime israélien pourrait finalement s’avérer contre-productive, en générant une résistance proportionnelle à l’oppression qu’il inflige.
Pour les Palestiniens, la suprématie d’Israël est un cauchemar existentiel. Gaza est en ruines ; pour sa population, intentionnellement affamée, assoiffée et sans cesse bombardée, la survie elle-même est devenue l’acte de résistance ultime.
En Cisjordanie, les communautés palestiniennes subissent une escalade de la violence des colons soutenue par l’État. Les démolitions de maisons, les confiscations de terres, les détentions arbitraires et le harcèlement quotidien se sont intensifiés jusqu’à atteindre des niveaux extrêmes.
La légitimité de l’Autorité palestinienne s’est depuis longtemps érodée, vidée de sa substance par les divisions internes et sa soumission excessive aux exigences israéliennes.
Pourtant, malgré les difficultés dues au paysage politique palestinien fragmenté, les communautés continuent de résister et de s’adapter avec détermination et une persévérance inébranlable.
Certes, la résilience palestinienne doit faire face à une pression extrême qui menace sans cesse de l’affaiblir, mais les fondements mêmes du pouvoir israélien cachent une profonde fragilité structurelle.
Sa domination repose sur la violence, le soutien étranger et la complicité des régimes arabes, et non sur la légitimité.
Construite sur la répression et la fragmentation, son architecture sécuritaire manque du seul fondement qui pourrait garantir une intégration régionale durable : une acceptation sincère des populations de la région, ce qui est impossible tant que persistent la dépossession, l’occupation et la violence coloniale.
En fin de compte, pour aller de l’avant, il nous faut nous unir derrière un leadership audacieux capable de transcender le factionnalisme palestinien et l’ordre arabe impotent et répressif, tout en tirant parti de l’élan de la solidarité mondiale avec la Palestine.
La résistance ne se limite plus aux roquettes ou aux pierres ; elle prospère dans les tribunaux, les campus universitaires et dans les arènes numériques et culturelles du monde entier. Il n’est pas certain qu’elle conduise à un changement transformateur, mais elle garantit que le projet colonialiste d’Israël sera confronté à des défis incessants.
La domination actuelle d’Israël est donc beaucoup plus précaire qu’il n’y paraît, et ne marque pas une fin, mais une phase instable dans une lutte continue et inachevée.
Traduction : Dominique Muselet pour Chronique de Palestine
L'auteur, Tariq Dana, est professeur adjoint d’études sur les conflits et l’humanitaire à l’Institut d’études supérieures de Doha, et chargé de cours à l’Université Northwestern au Qatar.
Il a été directeur du Centre d’études sur le développement de l’université de Birzeit et chercheur principal à l’Institut d’études internationales Ibrahim Abu-Lughod, à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève et à la School of Oriental and African Studies.
- Source : Al-Shabaka (Palestine)