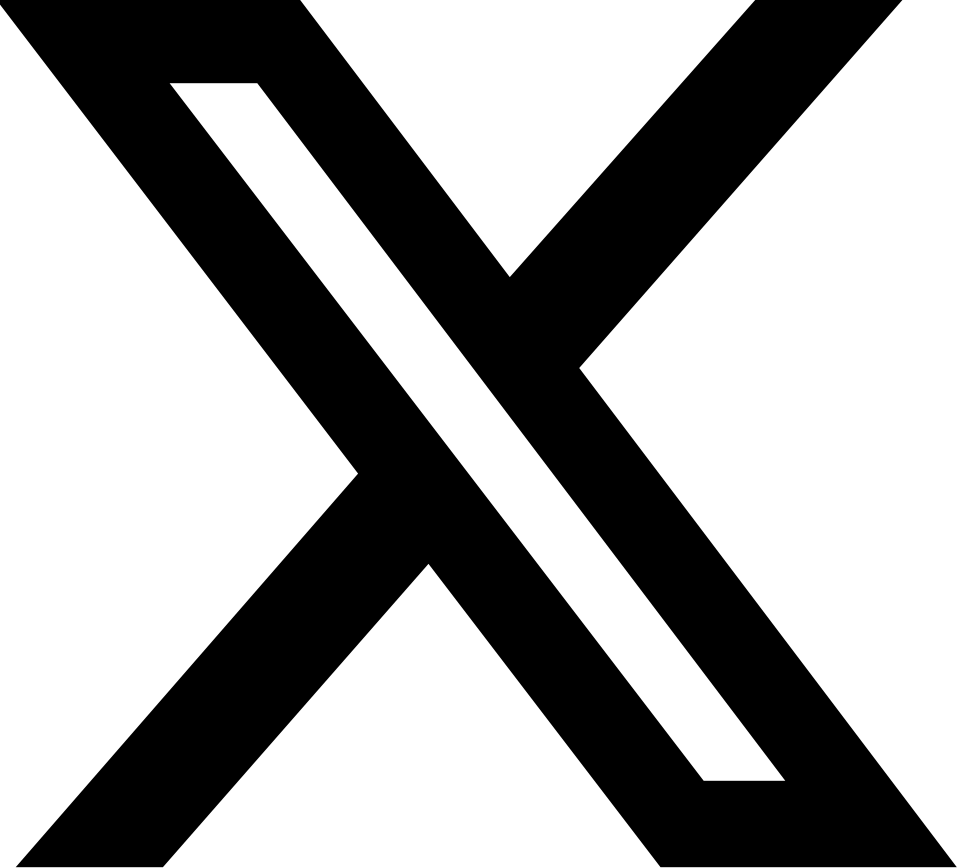L’éternel retour du chiffon

Le masque revient. Pas en fanfare, non. Il revient comme un fantôme qui aurait oublié de mourir. On croyait s’en être débarrassés, comme d’une vieille habitude honteuse. Mais non – le voilà qui refait surface, dans les rues, dans les supermarchés, dans les pharmacies, sur les visages de ceux qui ont encore peur de respirer. C’est presque attendrissant, cette fidélité à la panique.
Le masque, ce carré de tissu censé sauver le monde, redevient une tache dans le décor. Une anomalie qui flotte sur les bouches comme un rappel de la docilité. Chaque fois que je le revois, j’ai comme une remontée d’absurde. Les gestes barrières, les pass, les kilomètres de gel hydroalcoolique… tout remonte d’un coup. Une époque où l’on croyait qu’en se désinfectant les mains, on pouvait purifier l’humanité. C’était presque mignon, quelque part.
Certains le remettent sans réfléchir. Un réflexe conditionné, comme si la peur leur tenait encore la laisse. D’autres le font avec application, presque avec soulagement : se cacher leur va si bien.
Derrière cette muselière, ils se sentent protégés du monde, de l’autre, de la conversation, du miroir. Ils appellent ça de la prudence. Moi, j’appelle ça de la disparition volontaire.
La peur est une invention brillante. Elle transforme les gens normaux en pantins polis. Elle fait taire les cerveaux, coupe les voix, anesthésie les regards. Avec elle, on peut tout faire : priver de liberté, interdire de parler, isoler, punir. Tout passe, tant que c’est pour «le bien de tous». On l’a vu à l’œuvre. Elle a rendu certains fous, d’autres dociles, et a même emporté ceux qui n’ont pas su respirer sous le poids du délire collectif.
Il paraît que le masque est un objet sanitaire. Non. C’est un talisman de notre époque : la peur de l’autre cousue à même la peau. On est passé du contact à la distance, de la parole à la notification, du visage à l’écran. Une société où le silence est hygiénique et où le contrôle se vend sous l’étiquette de la vertu.
Certains résistent, d’autres obéissent. C’est le grand ballet des humains : les soumis et les respirants. Les premiers trouvent leur confort dans l’ordre. Les seconds, leur dignité dans le souffle. Mais le plus fascinant, c’est la facilité avec laquelle tout recommence.
En somme, ceux qui acceptent ont peur de mourir ; ceux qui refusent ont peur d’oublier qu’ils sont vivants. Alors, qui est fou ? Les uns, les autres ? Probablement tout le monde.
Mais peu importe. Le monde est devenu une pièce de théâtre sans spectateurs, et moi, je me contente de traverser la scène, les mains dans les poches, un demi-sourire aux lèvres. Comme dirait Guenièvre dans Kaamelott : «On n’est pas sorti du sable». Mais franchement, à ce stade, je m’en fous un peu du sable. Je marche dessus.
- Source : L’Observatoire d’Amal