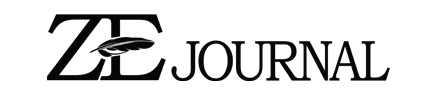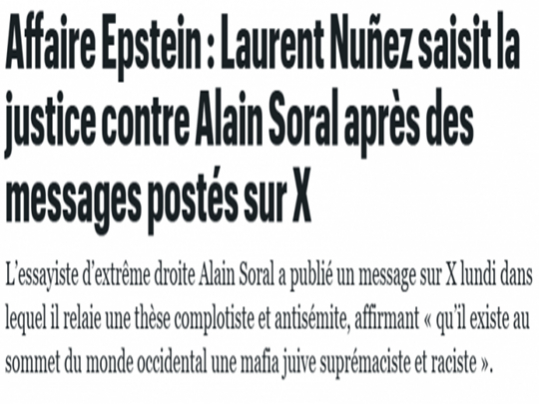Trump fait plier l’UE : 15 % de taxes sur les produits européens, zéro sur les produits américains

Dans un accord jugé humiliant par plusieurs observateurs européens,la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a entériné ce que beaucoup décrivent comme une capitulation : 15 % de droits de douane sur tous les biens européens exportés vers les États-Unis.
L’Union européenne a accepté des conditions commerciales largement favorables aux États-Unis. Donald Trump impose 15 % de droits de douane sur les exportations européennes, tandis que les produits américains entreront sans taxe sur le marché européen. En retour, l’UE s’engage à des achats massifs d’énergie et des investissements colossaux aux États-Unis.
Un accord pour la fin des liens énergétiques avec la Russie
Après des mois de tensions, ce dimanche 27 juillet 2025, depuis le parcours de golf de Turnberry, en Écosse Donald Trump a réaffirmé son style inimitable; imposant, imprévisible, mais parfois efficace.
Le président américain a imposé un tarif douanier de 15 % sur toutes les marchandises européennes, une mesure qui aurait pu être pire : Trump avait initialement menacé d’un tarif de 30 %. En face, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a capitulé: aucun droit de douane ne sera appliqué aux exportations américaines vers l’UE, notamment dans des secteurs clés comme l’agriculture, l’aéronautique ou encore les semi-conducteurs.
Ursula von der Leyen a pourtant parlé d’un « énorme contrat », affirmant qu’il apporterait une certaine stabilité. Mais à quel prix ?
Outre les déséquilibres tarifaires, l’Union européenne s’est engagée à :
- 750 milliards de dollars d’achats d’énergie américaine (notamment en GNL, pétrole et nucléaire),
- 600 milliards de dollars d’investissements directs dans l’économie américaine, y compris dans le secteur militaire.
Autrement dit, un transfert important de richesses vers les États-Unis, présenté comme une façon de réduire la dépendance énergétique européenne vis-à-vis de la Russie.
Même si certains secteurs comme les spiritueux français ou les industries viticoles néerlandaises espèrent obtenir des exemptions, beaucoup dénoncent un accord à sens unique.
Le ministre français Benjamin Haddad admet des « mérites ponctuels », mais reconnaît un « déséquilibre profond » du pacte, tandis que d'autres dirigeants européens appellent à la prudence.
En effet, la France avait prôné l’usage de mesures de rétorsion commerciales. Mais cette position est restée marginale face au poids économique allemand, d’autant que des figures comme Bernard Arnault ont publiquement plaidé pour une approche de compromis, par souci de préserver leurs intérêts transatlantiques.
L’unité européenne a une nouvelle fois été mise à l’épreuve — et a cédé sous la pression économique et diplomatique des États-Unis.
La stratégie Trump : imposer sa loi au commerce mondial
Cet accord s’inscrit dans une offensive commerciale plus large menée par Trump, qui a récemment conclu des accords similaires, bien que moins désavantageux, avec le Japon, l’Indonésie, ou encore le Royaume-Uni.
Son objectif est clair : réduire le déficit commercial américain, repositionner les États-Unis comme force dominante du commerce mondial, et surtout montrer aux électeurs américains que "America is winning again".
L’accord avec l’UE pourrait générer jusqu’à 90 milliards de dollars de recettes tarifaires pour Washington, sans compter les investissements européens attendus. En parallèle, les droits de douane punitifs sur l’acier et l’aluminium (jusqu’à 50 %) restent en vigueur.
Trump sort de cet accord avec l’image d’un négociateur implacable, qu’Ursula von der Leyen elle-même qualifie, avec une étrange admiration, de « faiseur de deals ».
« C’est formidable que nous ayons conclu un accord aujourd’hui au lieu de jouer et qu’en fin de compte, nous n’ayons pas d’accord. Je pense que c’est le plus gros accord qui ait jamais été »,
a déclaré Donald Trump, se référant probablement au PIB nominal total des États-Unis et de l’UE, qui représente près de la moitié du globe.
Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a exprimé ses inquiétudes : « Le commerce sera désormais plus coûteux et plus difficile pour nos entreprises ». Quant au chancelier allemand Friedrich Merz, il rappelle que « seule la stabilité et la réciprocité sont bénéfiques aux deux rives de l’Atlantique ».
Quand au Premier ministre hongrois Viktor Orban, il s'est toujours opposé à la «ligne générale de Bruxelles» et a ironisé ce matin:
« Ce n’est pas un accord. Donald Trump a mangé von der Leyen pour le petit-déjeuner »
Photo d'illustration: Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Turnbury, en Écosse, le 27 juillet 2025. Photo : Brendan Smiallowski / AFP / Scanpix / LETA
***
Pseudo-accord commercial : le caniche européen s’est couché devant son maître

Pouvait-il en être autrement ? Rappelons que l’Union européenne n’est qu’une illusion, une armée mexicaine dont les États-Unis sont l’unique «fédérateur», comme aurait dit de Gaulle. Quant à Ursula von der Leyen, c’est comme pour Christine Lagarde : il n’y a qu’à regarder son parcours et son niveau de corruption pour comprendre qu’elle n’est féroce qu’à l’égard des peuples européens… Comble d’ironie, même l’ectoplasme Bayrou parle de «soumission» à propos de cet «accord» ! En s’y résignant, naturellement…
L'UE CAPITULE DEVANT TRUMP !
— François Asselineau (@f_asselineau) July 27, 2025
accepte droits de 15% à l'entrée des produits aux
achètera plus de produits🇺🇸
-automobiles
-produits agricoles
-armement
-750 Mds$ d'énergie🇺🇸 !
investira 600 Mds$ aux🇺🇸
IL SEMBLE QUE TOUT ÇA SOIT SANS RÉCIPROCITÉ https://t.co/3EBKBNb9FI
BAYROU BAISSE DÉJÀ LES BRAS
— François Asselineau (@f_asselineau) July 28, 2025
FACE À L'ACCORD TRUMP-LEYEN !
Au lieu d'annoncer que la France met son veto à cet accord, il s'y soumet immédiatement... tout en dénonçant, par un tweet résigné, ceux qui précisément se résolvent à la soumission !!
=> Il est passif et… https://t.co/ydCN55FP30 pic.twitter.com/3Cfzi6onTu
source : Olivier Demeleunaere
***
L’addition européenne : 750 milliards pour le gaz US, 600 milliards d’investissements et 15% de douanes en bonus
La souveraineté économique semble n'est qu’un vague souvenir pour l’Union européenne : un nouvel accord commercial, signé le 27 juillet 2025 en Écosse, vient consacrer la soumission de Bruxelles aux exigences américaines. L’UE s’enfonce dans une dépendance humiliante, sous couvert d’un partenariat vanté comme historique.

Von der Leyen signe, Trump rit, l’Europe paie. Merci Oncle Sam !
Une capitulation déguisée en « grand accord »
Le président américain Donald Trump, fidèle à son style théâtral, a qualifié l’accord commercial conclu avec l’UE de « plus grand jamais signé ». Accompagné d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, il a annoncé, depuis l’Écosse, l’instauration de droits de douane de 15 % sur les exportations européennes vers les États-Unis. Ce taux, non négociable selon Trump, illustre l’asymétrie brutale des rapports de force. Loin d’être un compromis, cet accord ressemble à une capitulation en bonne et due forme, où l’UE, docile, accepte des conditions dictées par Washington. Les Européens, selon les termes de l’accord, s’engagent à injecter 600 milliards de dollars dans l’économie américaine et à acheter pour 750 milliards de dollars d’énergie made in USA, souvent à des prix exorbitants.
Ils vous ont fait sauter Nord Stream.
— Camille Moscow (@camille_moscow) July 27, 2025
Ils vous vendent maintenant leur gaz, deux fois plus cher.
Et vous dites merci.
C’est plus qu’une alliance, c’est une reddition économique. L’UE ne commerce plus : elle obéit. pic.twitter.com/uS3RsEZrKP
Le gaz américain : un marché captif à prix d’or
Depuis la destruction des gazoducs Nord Stream, l’UE, privée de ses approvisionnements russes à bas coût, s’est tournée vers le gaz naturel liquéfié (GNL) américain, vendu à des tarifs deux à trois fois supérieurs. Ce virage, loin d’être un choix stratégique, ressemble à une obligation imposée par une alliance transatlantique où l’Europe n’a plus voix au chapitre. Les 750 milliards de dollars promis pour l’achat d’énergie américaine ne font que renforcer cette dépendance énergétique. Pendant ce temps, les ménages européens subissent des factures énergétiques écrasantes, tandis que les industries peinent à rester compétitives face à des coûts prohibitifs. L’UE, en se pliant à ces exigences, sacrifie son autonomie au profit d’un partenaire qui dicte ses règles sans concessions.
Des droits de douane comme outil de domination
Les 15 % de droits de douane imposés sur les produits européens ne sont pas un simple ajustement commercial : ils traduisent une volonté américaine de rééquilibrer la balance commerciale à son avantage. Trump, avant même la rencontre en Écosse, avait fixé la barre, refusant catégoriquement un taux inférieur. Cette fermeté contraste avec la posture conciliante d’Ursula von der Leyen, qui a présenté ces droits comme un moyen de « rapprocher » les deux blocs économiques. Mais rapprocher qui, et à quel prix ? Les secteurs clés de l’UE, comme l’automobile, déjà fragilisés par des déséquilibres transatlantiques, risquent de pâtir lourdement de cette mesure. Les exportateurs européens, confrontés à ces nouvelles barrières, devront soit absorber les coûts, soit répercuter la hausse sur les consommateurs.
Une Europe vassalisée : la fin de la souveraineté économique
Cet accord, vanté comme un partenariat entre « les deux plus grandes économies du monde », cache une réalité bien plus amère. L’UE ne négocie plus : elle obéit. Les 600 milliards de dollars d’investissements promis aux États-Unis, loin de renforcer l’économie européenne, drainent des ressources cruciales hors du continent. Pendant ce temps, les citoyens européens, déjà asphyxiés par l’inflation et la crise énergétique, assistent impuissants à cette grande braderie de leur avenir. Trump, avec son ultimatum du 12 juillet menaçant de droits de douane à 30 % dès le 1er août, a su imposer ses conditions, exploitant les faiblesses structurelles d’une UE incapable de parler d’une seule voix.
Un cynisme transatlantique assumé
« Tout le monde doit être content », a déclaré Trump, avec une pointe d’ironie, en soulignant que l’accord, bien que « pas encore équitable », représente un pas vers une justice commerciale… à l’américaine. Cette rhétorique, habilement relayée par une Ursula von der Leyen en quête de légitimité, ne trompe personne. L’Europe, en acceptant ces termes, renonce à défendre ses intérêts et se condamne à une dépendance accrue. Les États-Unis, en imposant leurs conditions, confirment leur rôle de maître du jeu dans une alliance où l’UE n’est qu’un pion. Les Européens, eux, sont priés de dire « merci » pour ce privilège douteux.
***
« Accord » États-Unis / UE : Pour Medvedev, Trump a « écrasé l’Europe » avec un deal « totalement humiliant » pour Bruxelles
L’accord commercial signé le 27 juillet 2025 entre l’Union européenne et les États-Unis, prévoyant des droits de douane de 15 % sur les exportations européennes et des engagements massifs d’achats énergétiques, continue de faire couler de l’encre. Conclu sous la pression de l’administration Trump, ce « deal » est loin de faire l’unanimité. Entre résignation, colère et critiques acerbes, les réactions fusent, révélant une Europe fracturée face à cette capitulation face à Washington.

L’Europe négocie comme un vegan dans un steakhouse : tour d’horizon des réactions à cette humiliation européenne.
Giorgia Meloni : un optimisme prudent teinté de pragmatisme
La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a salué l’accord comme une victoire diplomatique, soulignant qu’il « évite une guerre commerciale aux conséquences imprévisibles et potentiellement dévastatrices ». Dans un communiqué conjoint avec ses vice-Premiers ministres, Antonio Tajani et Matteo Salvini, elle a insisté sur la nécessité d’examiner les détails avant de porter un jugement définitif. « Il est positif qu’un accord ait été trouvé, mais nous devons travailler pour protéger les secteurs vulnérables », a-t-elle déclaré depuis Addis-Abeba, où elle assistait à un sommet de l’ONU. Ce ton mesuré cache une réalité : Meloni, souvent vue comme une interlocutrice privilégiée de Trump en Europe, cherche à ménager les intérêts italiens tout en évitant de froisser Washington. Son gouvernement promet des mesures nationales pour amortir l’impact des 15 % de droits de douane, mais appelle aussi à un soutien européen pour les industries touchées, notamment l’automobile et l’agroalimentaire.
Meloni : “Une guerre commerciale UE–USA serait dévastatrice. L’accord à 15 % est viable, mais il manque trop d’infos. Il faudra compenser les secteurs fragiles.”
— Camille Moscow (@camille_moscow) July 28, 2025
Traduction : l’UE signe un accord flou, contraignant, aux conséquences économiques incertaines. Et maintenant,… pic.twitter.com/boeWkW7y4v
François Bayrou : un « jour sombre » pour l’Europe
Chez nous en France, la réaction est bien plus virulente. Notre cher Premier ministre François Bayrou a dénoncé un « jour sombre » pour l’UE, accusant l’accord de consacrer « la soumission d’une alliance de peuples libres ». Sur X, il a fustigé la passivité d’Ursula von der Leyen face aux exigences américaines, un sentiment partagé par une large partie de la classe politique française. « Ce n’est pas un accord, c’est une reddition », a-t-il martelé, pointant du doigt les 750 milliards de dollars d’achats d’énergie promis à Washington et les 600 milliards d’investissements européens aux États-Unis. Cette sortie illustre l’exaspération d’une France qui craint de voir ses exportations, notamment dans le vin et le luxe, lourdement pénalisées par les nouvelles taxes.
Accord Van der Leyen-Trump : c'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission.
— François Bayrou (@bayrou) July 28, 2025
Lavrov et Medvedev : la Russie se gausse de l’humiliation européenne
Du côté de Moscou, les réactions ne se font pas attendre et prennent un ton jubilatoire. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié l’accord de « coup très dur » pour l’industrie européenne, prédisant une « désindustrialisation accélérée » et une fuite des investissements vers les États-Unis. « L’UE exporte taxé à 15 %, pendant que Washington dicte ses conditions. C’est une leçon de realpolitik », a-t-il ironisé lors d’un forum près de Moscou. Plus virulent encore, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, n’a pas mâché ses mots en déclarant déclaré que Trump avait « écrasé l’Europe » avec un accord « totalement humiliant » pour Bruxelles, ajoutant que « les Européens ordinaires devraient prendre d’assaut Bruxelles » face à une telle capitulation.
Lavrov résume l’accord :
— Camille Moscow (@camille_moscow) July 28, 2025
– L’UE exporte taxé à 15 %
– Les USA exportent sans taxe
– L’Europe paie 750 Mds $ pour du gaz US + cher
– Refus total d’énergie russe
– 600 Mds $ d’investissements… envoyés aux USA
Selon le ministre des affaires étrangères russe, L’UE se ruine… pic.twitter.com/HCp8530Fem
L’Allemagne : un soulagement teinté de résignation
En Allemagne, où l’économie repose essentiellement sur les exportations, les réactions oscillent entre pragmatisme et inquiétude. Le chancelier Friedrich Merz a salué un accord qui « évite une escalade inutile » dans les relations transatlantiques, mais n’a pas caché sa déception face à l’absence d’allègements plus conséquents. La fédération allemande de l’industrie (BDI) a prédit des « répercussions négatives considérables », tandis que la VDA, représentant les constructeurs automobiles, a déploré des pertes de « milliards d’euros » pour le secteur automobile. La fédération de la chimie (VCI) a comparé l’accord à une « simple tempête » face à l’« ouragan » redouté des 30 % de droits de douane initialement menacés par Trump. Cette résignation traduit une Europe qui, faute de mieux, accepte un compromis déséquilibré pour éviter le pire.
Une Europe divisée face à un « deal » asymétrique
D’autres voix européennes reflètent cette fracture. En Irlande, le gouvernement a exprimé des regrets face à un accord qui rendra le commerce « plus cher et plus difficile », tout en reconnaissant qu’il apporte une « certitude nécessaire » après des mois d’incertitude. En Hongrie, Viktor Orban a raillé Ursula von der Leyen, lançant sur Facebook que « Trump l’a mangée au petit déjeuner ». En France, l’économiste Eric Dor a dénoncé une « victoire par intimidation » de Trump, qui a su exploiter la menace de taxes à 30 % pour imposer ses conditions.
- Source : Le Courrier des Stratèges