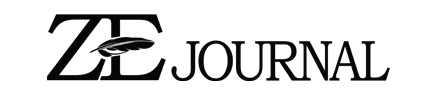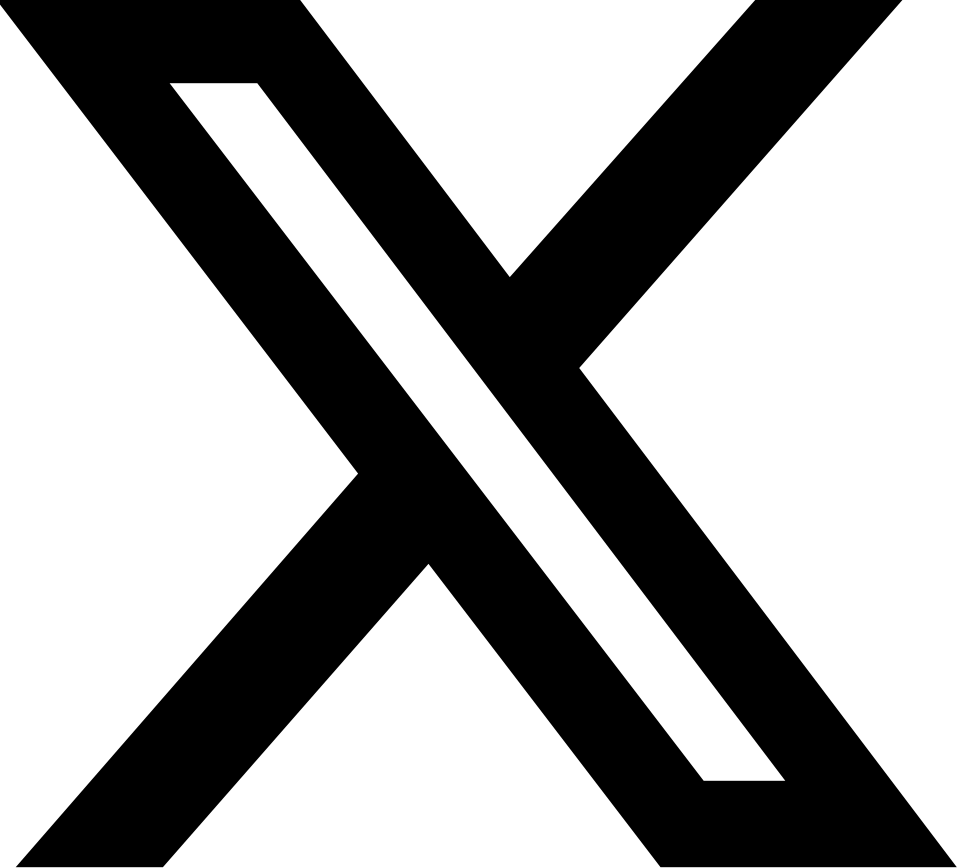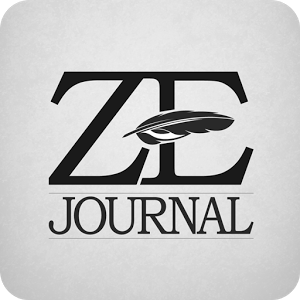Le Qatar, et non Israël, désormais au cœur de la stratégie de Trump au Moyen-Orient?

La promesse militaire sans précédent faite par Trump au Qatar a pris les analystes au dépourvu. Ce qui avait commencé comme une réaction à une frappe israélienne pourrait désormais redéfinir les relations des États-Unis avec le Golfe et marquer un changement historique dans leur approche privilégiant Israël.
Les États-Unis sont devenus, de fait, le garant militaire du Qatar. Avec le décret sans précédent signé par Trump le 29 septembre 2025, Washington « considérera désormais toute attaque armée contre le territoire, la souveraineté ou les infrastructures critiques » du Qatar comme une menace pour les États-Unis, s’engageant à répondre par des mesures « militaires », « si nécessaire ».
Pour la première fois, à l’exception de la Turquie membre de l’OTAN, les États-Unis se sont officiellement engagés à défendre un partenaire régional au Moyen-Orient (autre qu’Israël).
L’expert Bilal Y. Saab estime que cette décision est « accidentelle » dans le sens où elle semble avoir été prise à la hâte, voire de manière imprudente, mais qu’elle n’en est pas moins importante pour autant. Le moment choisi suggère en effet que cette garantie militaire est moins l’aboutissement d’une longue planification stratégique qu’un pari réactif, un réajustement audacieux de la position des États-Unis envers le Qatar et, par extension, le Golfe.
J’écris depuis longtemps sur l’importance géopolitique du Qatar en tant qu’acteur « petit État » amplifié, pour ainsi dire, un acteur diplomatique majeur dans une région instable. En mai, j’ai fait valoir que la tournée de Trump dans le Golfe (Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis), qui excluait notamment Israël, indiquait une tentative délibérée de rééquilibrer les relations déjà assez complexes entre les États-Unis et Israël. À l’époque, j’avais observé que si les actions de Trump dans le Golfe semblaient relever du transactionnel, elles servaient également à rappeler subtilement, même à l’allié le plus proche de Washington (Israël), qu’il ne pouvait pas agir sans contrôle.
Les États du Golfe, avec leur poids financier et leur rôle de médiateurs (notamment à Gaza et parfois même en Ukraine), offrent sans doute plus d’immédiateté et d’influence à la vision de Trump qu’Israël ne le fait parfois. Dans cette optique, l’élévation du Qatar au statut de protectorat de facto pourrait être la prochaine étape logique d’un pivot plus large.
Il est certain que le Qatar n’est pas un nouveau venu dans la diplomatie régionale en coulisses. Dès 2021, j’ai relaté comment les autorités qataries à Doha, même pendant le blocus du Golfe (2017-2021), ont maintenu des canaux de communication secrets avec l’Iran et la Turquie, puis ont négocié des réconciliations entre les États du Golfe eux-mêmes. La capacité du Qatar à jouer entre Riyad et Téhéran, Ankara et Washington, fait partie de son capital diplomatique. En bref, le portefeuille de médiation du Qatar lui a valu une influence démesurée.
Alors, comment expliquer cette garantie sans précédent de Trump ? Plusieurs dynamiques interdépendantes sont en jeu, et cette décision ne peut être réduite à une simple démonstration de force théâtrale.
Tout d’abord, le déclencheur immédiat a clairement été l’attaque à la roquette menée par Israël le 9 septembre contre Doha, qui visait des membres du Hamas pendant les négociations de cessez-le-feu. L’attaque a tué un agent de sécurité qatari et a bouleversé l’équilibre diplomatique. Netanyahu a finalement présenté ses excuses, sous la pression de Trump, lors d’un appel téléphonique au Premier ministre qatari bin Abdulrahman. Mais cela n’a pas suffi. En peu de temps, Trump a signé le décret présidentiel, consolidant ainsi ses excuses. Cette garantie renforce le rôle de médiateur du Qatar (que la Maison Blanche soutient explicitement dans le texte) et dissuade Israël de réitérer ses frappes contre ce pays arabe.
Deuxièmement, cette décision est représentative de l’orientation de Trump vers le Golfe et de sa réévaluation des hypothèses régionales de Washington, notamment en ce qui concerne le réaménagement de l’axe américano-israélien. En renforçant aussi ouvertement le pouvoir du Qatar, Trump signale que les États du Golfe peuvent obtenir de Washington une réciprocité plus directe que ce à quoi Israël pourrait s’attendre — un message direct, mais conforme à sa vision transactionnelle de la politique étrangère. Le calcul est le suivant : si le Qatar sert de médiateur entre Gaza, la Russie et l’Ukraine voire l’Iran, alors le lier militairement garantit un alignement durable. Cela est peu mentionné dans la plupart des commentaires, mais jusqu’à présent, la garantie qatarienne fonctionne à la fois comme un bouclier et un moyen de contrôle, pour ainsi dire.
Troisièmement, il s’agit également d’un pari sur la dissuasion comme moyen diplomatique. En rehaussant le statut du Qatar grâce à des garanties de défense formalisées, les États-Unis cherchent à faire peser un risque sur tout État qui envisagerait de frapper Doha. Cela dit, la critique de Saab mérite d’être prise en considération : un décret présidentiel est facilement réversible, il ne bénéficie pas du soutien du Congrès et, dans la pratique, il n’engage pas vraiment les États-Unis. À y regarder de plus près, la crédibilité d’une telle garantie est donc discutable. Si Israël bombarde à nouveau, les États-Unis s’opposeront-ils ? Si l’Iran ou ses mandataires attaquent Doha, Trump risquera-t-il la vie d’Américains ? L’absence d’obligations mutuelles dans le texte est également une omission frappante.
Quatrièmement, cela pourrait être un message adressé aux autres puissances du Golfe qui envisagent des garanties. L’Arabie saoudite, en particulier, cherche depuis longtemps à conclure un pacte de défense mutuelle avec les États-Unis, notamment dans le cadre de la normalisation de ses relations avec Israël. Mais c’est le Qatar qui a obtenu le premier cette récompense. Washington peut-il se permettre de prendre des engagements formels envers plusieurs États du Golfe ? Cela reviendrait à s’étendre stratégiquement de manière excessive. Quoi qu’il en soit, le Qatar devient en quelque sorte un cas test, un baromètre permettant de déterminer si les États-Unis sont prêts à ancrer la sécurité régionale plutôt que de l’externaliser.
Cette garantie donnée par Trump reflète en fin de compte un changement plus large : le Golfe est sans doute devenu le centre de gravité de la géopolitique au Moyen-Orient, et pas seulement Israël. Les États-Unis cherchent désormais à s’ancrer plus profondément dans les réseaux d’intermédiation régionaux, et il semblerait que le petit Qatar, toujours gracieux malgré les turbulences, soit le moyen qu’ils ont choisi pour y parvenir.
Pourtant, l’histoire nous rappelle que le pouvoir ne se manifeste pas seulement sur le papier, mais aussi par la présence. Pour que cette garantie soit plus qu’une simple figure de style, Washington devrait traduire ses paroles en actes : exercices conjoints, défenses antimissiles, etc.
En fin de compte, il ne faut ni rejeter cette garantie surprise comme une mise en scène impulsive, ni l’accepter telle quelle comme un traité solide. Il faut plutôt (comme c’est le cas pour tant d’autres choses concernant Trump) la considérer comme un pari audacieux.
Dans ce scénario, ce moment pourrait marquer le début d’un véritable nouvel accord entre les États-Unis et le Golfe : le Qatar comme partenaire militaire, médiateur et semi-bouclier, Washington étant plus que jamais lié à l’échiquier du Golfe. Il faut également s’attendre à de nouvelles complications résultant d’une relation américano-israélienne qui est aujourd’hui plus complexe que jamais.
Traduction : Mondialisation.ca
L'auteur, Uriel Araujo, est un chercheur spécialisé dans les conflits internationaux et ethniques.
- Source : InfoBrics