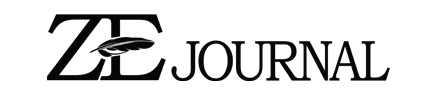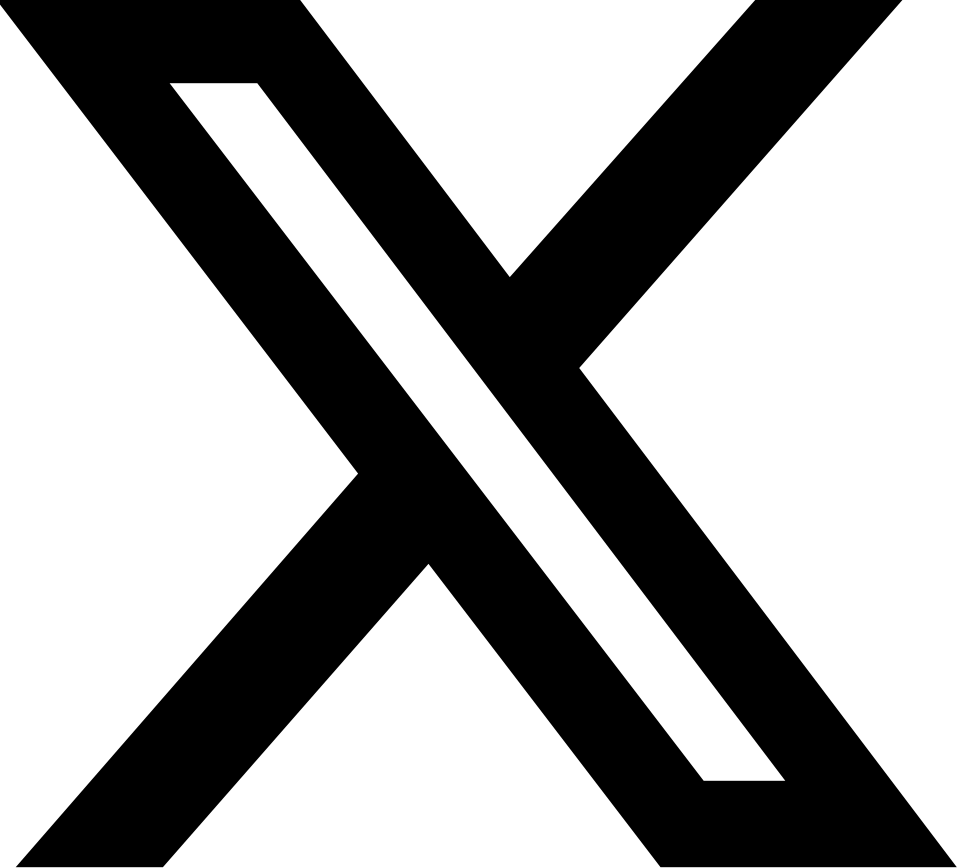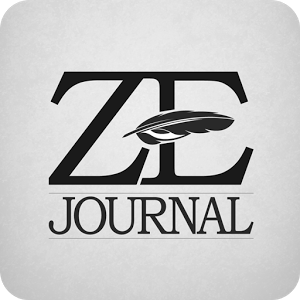Ce gigantesque incendie tombe à pic pour un certain projet…

Les essentiels de cette actualité
- Le 5 août 2025, un incendie ravage 160 km² des Corbières, détruisant un écosystème protégé. Les promoteurs solaires y voient une opportunité pour le projet « Grand Crès ».
- Les enquêteurs évoquent un mégot, mais les habitants soupçonnent une piste industrielle. Les sociétés impliquées possèdent l’expertise pour déclencher un feu discret.
- Des précédents similaires en Gironde en 2022 montrent que le feu peut être un outil de reconversion territoriale. Les zones incendiées deviennent des pages blanches pour les investisseurs.
- L’Aude entre dans une nouvelle phase d’aménagement. Les promoteurs utilisent le vocabulaire de la résilience pour imposer leurs projets énergétiques.
Feu et intérêts convergents
Le 5 août 2025, le massif des Corbières a été frappé par un incendie d’une violence inédite. En quelques heures, 160 km² ont été engloutis par les flammes, réduisant en cendres l’écosystème que les habitants de Ribaute et Tournissan défendaient depuis des années.
Ce terrain, farouchement protégé contre le projet « Grand Crès », se retrouve aujourd’hui rasé, débarrassé de la végétation qui constituait l’un des principaux obstacles à l’aménagement industriel. Les promoteurs de l’énergie solaire n’ont plus devant eux qu’un plateau noirci, prêt à accueillir leurs structures métalliques. L’opération de persuasion citoyenne avait échoué ; l’opération par le feu a réussi.
Hexagone Énergie, bras opérationnel de Neoen et Investisun, voit désormais s’ouvrir un boulevard. Là où la biodiversité constituait une barrière juridique, le vide écologique devient un argument d’implantation. Les rapports environnementaux, jusqu’ici défavorables, pourront désormais conclure à l’absence d’impact sur un biotope déjà détruit. L’incendie n’est plus seulement un drame humain et naturel ; il devient un levier stratégique, transformant un rejet massif en opportunité commerciale.
Les traces invisibles
Les enquêteurs officiels pointent un mégot comme cause probable, mais ce scénario repose sur des traces volatiles et un périmètre saturé de fumée. Aucune caméra n’a saisi l’instant de l’embrasement, aucun témoin n’a vu la main fautive. Dans ce vide, la piste industrielle s’impose aux esprits locaux. Les habitants connaissent la valeur marchande des terres déboisées ; ils savent que les assurances, les subventions et la pression politique peuvent faire disparaître en quelques mois les freins à un projet énergétique d’ampleur.
Les sociétés impliquées possèdent l’expertise technique pour déclencher un feu discret : allume-feux à retardement, synchronisation avec un vent violent, localisation à un point précis pour garantir la propagation. Un tel incendie, une fois lancé, devient incontrôlable pour les secours et imparable pour les argumentaires d’aménagement. Les mêmes acteurs qui perdaient la bataille démocratique la remportent sur le terrain brûlé.
Les précédents occultés
Cette mécanique n’a rien de nouveau. Trois ans auparavant, en juillet 2022, un brasier d’ampleur similaire avait réduit en cendres la forêt usagère au pied de la dune du Pilat, en Gironde. 80 % du couvert forestier disparu, cinq campings emblématiques rayés de la carte, des milliers de vacanciers évacués dans la panique. La catastrophe avait officiellement été attribuée à un incendie d’origine accidentelle, mais le résultat final avait tout d’un scénario déjà écrit : libérer un espace protégé pour le reconfigurer.
La forêt incendiée devient une page blanche. Les anciens acteurs touristiques, affaiblis par les pertes, cèdent la place à des investisseurs vantant des projets d’« écotourisme » et d’installations énergétiques durables. Les structures « vertes » trouvent ainsi un espace que ni la loi ni la mobilisation citoyenne ne leur avaient jusque-là permis de conquérir. Le feu devient l’outil silencieux d’une reconversion territoriale.
Le nouvel horizon
Avec la disparition du couvert forestier, l’Aude entre dans une nouvelle phase d’aménagement. Les cartes cadastrales sont révisées, les zones incendiées classées comme terres à reconvertir. Dans les couloirs des ministères, le dossier « Grand Crès » revient à l’ordre du jour, cette fois porté par l’argument de « reconstruction énergétique ». Les mêmes habitants qui votaient à 97 % contre se retrouvent confrontés à une réalité physique irréversible.
Les promoteurs avancent désormais masqués derrière le vocabulaire de la résilience : “transformer le drame en avenir”, “faire du noir la couleur de la transition”. Ce langage masque mal une évidence : là où la démocratie avait fermé la porte, les flammes l’ont ouverte. L’incendie des Corbières n’est plus seulement une tragédie locale ; il est la démonstration brutale que, dans la guerre pour le territoire, le feu peut devenir l’arme invisible des vainqueurs.
- Source : Géopolitique Profonde