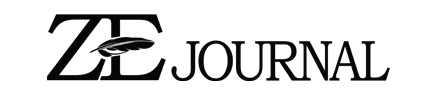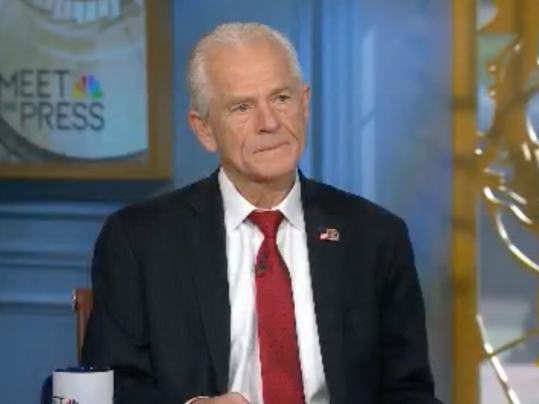Hôpital public : quand l'État planifie la pénurie

Tandis que la Drees annonce la fermeture de 2 000 lits d’hospitalisation complète en 2024, le soi-disant "ralentissement" de la baisse masque une décennie de désengagement . Ce recul des capacités hospitalières de 11% en dix ans n’est pas le fruit du progrès médical, mais la conséquence d’un planisme centralisé asphyxiant et déconnecté des besoins réels des patients.
Un système qui ferme des lits, mais ouvre des cases administratives
La France ferme des lits d’hospitalisation complète depuis vingt ans, et l’année 2024 ne fait pas exception. Les 2 000 lits supprimés s’ajoutent aux 45 500 lits perdus depuis 2013.
La Drees explique que le « virage ambulatoire » justifierait ces fermetures. Cette rhétorique masque un simple manque de personnel , qui est une conséquence directe de décennies de gestion centralisée, de rigidités statutaires et d’un État qui préfère la communication à l’efficience. En réalité, les hôpitaux ne ferment pas des lits par stratégie, mais par incapacité.
En parallèle de cette rétractation des lits, la progression des places d’hospitalisation partielle (+3,1 % en 2024) et à domicile (+5,5 %) est saluée comme un succès. Ce prétendu « virage ambulatoire » n'est bien souvent qu'un euphémisme.
Au lieu d'investir dans un système compétitif et décentralisé qui offrirait de réels choix de prise en charge, la bureaucratie sanitaire préfère transférer la charge du soin sur l’individu et la famille. En délocalisant le patient hors des murs de l’hôpital, l’État minimise son passif visible sur ses bilans.
On ne soigne pas mieux, on déplace le problème et on augmente la pression sur les aidants non rémunérés et les structures de ville, qui ne sont pas toujours équipées pour gérer des cas complexes. La diminution de 1,7 % des lits d'obstétrique en 2024, par exemple, révèle une pression croissante sur des moments cruciaux de la vie, forçant une rotation toujours plus rapide des patients.
L’hôpital public se transforme en réseau de « structures de passage », où le patient est renvoyé chez lui dès que possible, non par conviction médicale, mais par contrainte budgétaire.
L’hospitalisation partielle : une solution qui arrange d’abord l’administration
Face à la concurrence internationale et à la complexité des carrières médicales et soignantes, le système public, rigide et incapable d'offrir une rémunération dynamique ou des conditions de travail flexibles, échoue à attirer et à retenir ses talents.
Les lits fermés ne le sont pas par manque de murs, mais par manque de soignants qualifiés, contraints par des règles administratives d’un autre temps. C’est le dirigisme qui organise la pénurie de main-d’œuvre , laissant le patient face à un système qui se délite de l'intérieur.
L’hospitalisation complète devient luxueuse, et surtout réservée à ceux qui vivent dans les régions bien dotées. Les disparités territoriales, notamment en réanimation néonatale, confirment ce délitement.
Les lits ne manquent pas : ce sont les soignants que l’État n’a pas su garder. Et plutôt que de réformer, il préfère réduire l’offre pour que le modèle tienne artificiellement.
Le constat est sans appel : le contribuable continue de financer un hôpital public à coups de milliards d’euros prélevés chaque année. Pourtant, ces moyens n’iront certainement pas aux soins. Ils profiteront à une bureaucratie vorace dont la spécialité est de se nourrir sur le dos de l’intérêt général, alourdissant les procédures.
La rareté des lits d’hospitalisation est la conséquence directe d’un modèle étatisé qui a substitué la logique du comptable à celle du soignant.
- Source : Le Courrier des Stratèges