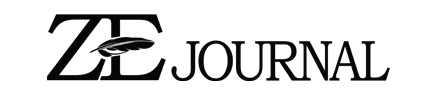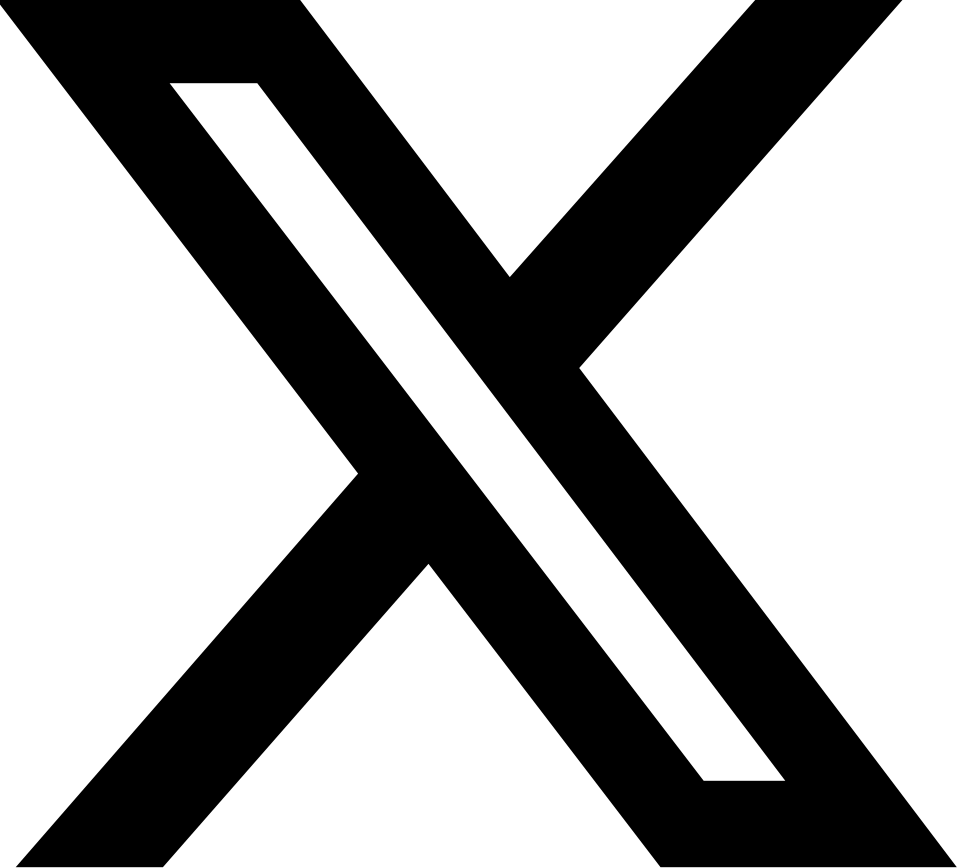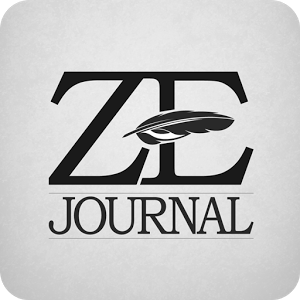Les États-Unis préparent-ils la guerre contre le Venezuela?

Les États-Unis ont déployé une énorme flotte de guerre au large des côtes du Venezuela, avec des attaques meurtrières déjà menées sous le prétexte de la « guerre contre la drogue ». Le véritable enjeu est un changement de régime visant à s'emparer des gigantesques réserves de pétrole du Venezuela et à neutraliser sa politique souveraine.
Tambours de guerre dans les Caraïbes
Supposons qu’une flotte russe ou chinoise se stationne au large de nos côtes en Europe et torpille des navires. Nous serions immédiatement au plus haut niveau d’alerte et prendrions toutes les dispositions nécessaires pour repousser une attaque militaire.
Ceci n’est pas de la fiction, mais correspond exactement à ce qui se déroule actuellement au large des côtes du Venezuela, où les États-Unis ont déployé une flotte de guerre ces dernières semaines. Celle-ci comprend des destroyers, des navires de guerre dotés de lance-missiles, des chasseurs F-35, des avions de reconnaissance, un sous-marin d’attaque, plus de 4 000 Marines et même un sous-marin nucléaire.
En outre, on estime qu’environ 10 000 militaires américains se trouvent dans la région, principalement à Porto Rico et sur des navires amphibies.
Cette flotte de guerre n’est pas un simple défilé. Au cours des dernières semaines, le gouvernement Trump a fait mener au moins cinq attaques meurtrières contre des embarcations qu’il qualifie, sans preuve, de « navires de la drogue ». Ces attaques ont fait 27 morts. Dans ces cas, il n’y a eu ni arrestation ni procès. L’Association du Barreau de New York (New York City Bar Association) condamne ces actes de guerre comme des « exécutions extrajudiciaires illégales — des meurtres ».
Comme si les attaques maritimes ne suffisaient pas, des bombardiers B-52 ont été aperçus à proximité de l’espace aérien vénézuélien. Parallèlement, le président Trump a admis ouvertement avoir donné le feu vert à la CIA pour des opérations secrètes au Venezuela, selon des sources américaines, avec un mandat assez large, allant de la coopération avec des groupes d’opposition locaux à des actions létales sur le territoire vénézuélien.
Le déploiement de guerre et les attaques contre les navires sont présentés comme une « guerre contre la drogue », mais cet alibi ne tient pas pour deux raisons. Premièrement, la Colombie et l’Équateur constituent les principales routes de la cocaïne vers les États-Unis. Le Venezuela ne joue tout au plus qu’un rôle secondaire dans ce trafic de drogue.
Deuxièmement, il est évident qu’un dispositif militaire d’une telle ampleur est totalement inadapté à une simple opération contre le trafic de drogue.
Un objectif bien plus agressif est poursuivi ici. Le gouvernement Trump ne le dit pas ouvertement, mais il est clair qu’il maintient l’option d’attaques terrestres ouvertes, visant un changement de régime.
Motifs révélés
Aux yeux de Washington, le Venezuela combine trois « péchés » : les plus grandes réserves de pétrole au monde sur lesquelles les États-Unis n’ont aucune prise, une politique étrangère souveraine — marquée par des alliances avec la Chine, la Russie, l’Iran, l’OPEP et des réseaux Sud-Sud — et un projet social qui utilise les richesses naturelles à des fins publiques.
C’est pourquoi, depuis l’élection d’Hugo Chávez en 1998, les États-Unis ont tout mis en œuvre pour réaliser un changement de régime et installer un gouvernement fantoche. Cela s’est traduit par des sanctions économiques, une guerre diplomatique, des tentatives de coup d’État, des tentatives d’influence et de manipulation électorale, et des opérations secrètes.
Récemment, la générale Laura Richardson, l’ancienne commandante de l’U.S. Southern Command— qui dirige les opérations militaires américaines dans les Caraïbes et autour du Venezuela — a admis ouvertement ce que Washington dissimule d’ordinaire derrière des mots comme « démocratie » et « droits de l’homme ».
Selon elle, la politique des États-Unis en Amérique latine tourne en réalité autour du contrôle des immenses richesses naturelles de la région — pétrole, lithium, or et terres rares — nécessaires à la puissance militaire et technologique occidentale.
Elle a surtout désigné les énormes réserves de ressources du Venezuela comme la véritable raison derrière les décennies de tentatives de changement de régime et de sanctions économiques contre le pays.
Une « colombe de la paix » comme cache-sexe pour la guerre
Dans le théâtre politique, un visage « acceptable » pour les États-Unis apparaît pour remplacer l’actuel président Maduro : la cheffe de l’opposition d’extrême droite María Corina Machado.
Avec le soutien de hauts responsables à Washington et un Prix Nobel de la Paix en poche, elle est présentée sur la scène internationale comme une alternative démocratique — malgré son rôle dans la tentative de coup d’État de 2002, son soutien ouvert aux sanctions et aux manifestations de rue violentes en 2014 et 2017.
La position de Machado est claire depuis des années : pas de négociation, augmenter la pression, durcir les sanctions et, au besoin, une intervention militaire. Son Prix Nobel arrive précisément au moment où Washington prépare la guerre contre le Venezuela. Est-ce un hasard ?
En tout cas, il est carrément cynique qu’elle soit utilisée en Occident comme icône de paix au moment où Trump parle ouvertement d’attaques terrestres qu’elle approuve et encourage.
Condamnation ferme
En raison de cette menace militaire, le gouvernement vénézuélien a demandé une session d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies. Il y a été appelé à la désescalade et au respect du droit international. Le secrétaire général adjoint de l’ONU a souligné que les États membres doivent mener leurs opérations antidrogue conformément au droit international.
Dans le pays, le président Nicolás Maduro réagit par des exercices de défense nationaux, le plan « Indépendance 200 », tout en soulignant l’appel au dialogue. À Caracas et dans l’État de Miranda, des milices civiles, la police et l’armée s’entraînent ensemble pour protéger les infrastructures stratégiques telles que l’électricité, l’approvisionnement en eau et les hôpitaux.
En Amérique latine, on travaille pendant ce temps à la formation de brigades internationalistespour soutenir le Venezuela. Selon João Pedro Stédile, dirigeant du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST) brésilien, des organisations sociales de différents pays d’Amérique latine coordonnent leurs efforts pour envoyer des militants afin d’aider à défendre le Venezuela contre l’agression des États-Unis.
L’inspiration vient des brigades internationales de la Guerre civile espagnole, lorsque des volontaires de nombreux pays sont venus défendre la République espagnole.
Plusieurs présidents de la région se sont exprimés contre la menace de guerre de Washington. Gustavo Petro, le président de la Colombie, a averti que toute attaque contre le Venezuela serait considérée comme une agression contre toute l’Amérique latine et les Caraïbes.
« L’Amérique latine, l’Amérique du Sud et les Caraïbes doivent maintenant s’unir pour rejeter et répondre à toute agression contre la patrie de Bolívar et le territoire latino-américain et caribéen, sans rhétorique. Le Venezuela appartient au peuple vénézuélien », a déclaré Petro.
Le président brésilien Lula s’est également exprimé avec force contre l’agression des États-Unis : « Le peuple vénézuélien est maître de son propre avenir. Et aucun président d’un autre pays n’a à déterminer ce que sera le Venezuela ».
La Chine a condamné toute menace ou usage de la force dans les relations internationales. Pékin rejette résolument toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Venezuela, sous quelque prétexte que ce soit. Il condamne toute action qui met en danger la paix et la stabilité dans la région.
Aux États-Unis, un groupe de sénateurs des deux partis a déposé une résolution visant à empêcher le président Trump de mener des actions militaires contre le Venezuela sans l’approbation du Congrès. Ils veulent ainsi rétablir la compétence constitutionnelle du Congrès de déclarer la guerre et stopper l’expansion du pouvoir militaire de Trump dans les Caraïbes sous le prétexte de la « guerre contre la drogue ».
Il est également très remarquable que l’amiral Alvin Holsey, chef du US Southern Command, ait présenté sa démission. Selon le New York Times, Holsey s’oppose au déploiement massif de troupes dans la région et au bombardement de cinq bateaux vénézuéliens, des attaques pour lesquelles aucune preuve n’a été fournie qu’il s’agissait de navires de drogue.
Au sein du Pentagone, de graves divergences seraient apparues entre Holsey et le ministre de la Guerre Pete Hegseth, et selon Reuters, l’amiral est parti juste avant un possible limogeage.
Pétrole, idéologie et mensonges
Quiconque repense à 2003 voit facilement des parallèles. À l’époque, les armes de destruction massive devaient justifier l’invasion de l’Irak. L’objectif réel était une reconfiguration géopolitique et le contrôle du pétrole.
Aujourd’hui, le « narco-terrorisme » et une « menace pour les États-Unis » servent de prétextes rhétoriques. Le but final reste le même : changement de régime et démantèlement de la Révolution bolivarienne, un important point de référence anticolonial en Amérique latine.
L’histoire montre que les interventions militaires exigent un lourd tribut : des milliers et des milliers de morts, des pays dévastés et une région dans une instabilité permanente. Pensez à l’Irak et à la Libye. L’actuelle montée en puissance militaire au large des côtes du Venezuela est donc extrêmement inquiétante et doit être condamnée de la manière la plus ferme possible.
Image en vedette : Capture d’écran. Source : indiatoday.in
- Source : Mondialisation (Canada)