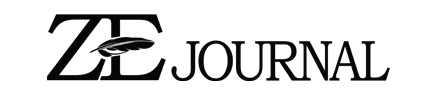Le Conseil d’État a tranché : l’écriture inclusive à l’université, c’est OUI !
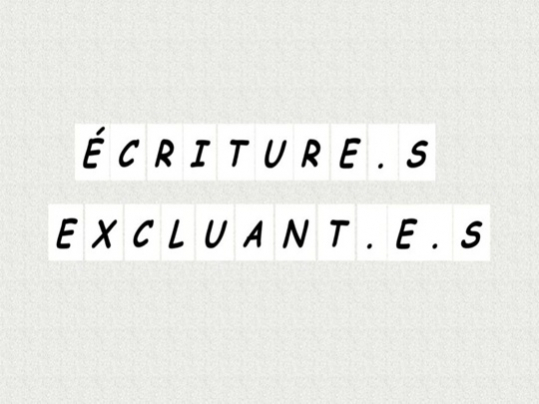
Le 6 août, en pleine canicule, le Conseil d’État a tranché : si l’écriture inclusive est bannie des textes officiels, elle ne l’est pas des lieux d’enseignement. Cela, au nom de « la liberté académique ».
L’écriture inclusive n’est rien d’autre que le cancer woke qui ronge la langue française. Une langue toujours plus malmenée et toujours moins maîtrisée. Qu’importe : la religion de « l’inclusion » a ses dogmes auxquels on ne saurait déroger. Chargé d’en finir une fois pour toutes avec le neutre masculin qui fait l’originalité de notre langue, le point médian est son emblème. Et qu’importe, là encore, si les paroles d’Aznavour – « Ils sont venus/Ils sont tous là/Dès qu'ils ont entendu ce cri/Elle va mourir, la mamma » (soit, Iels sont venu.e.s, iels sont tous/tes là, dès qu’iels ont entendu ce/tte cri, iel va mourir le/la mamma ?...) – sont devenues inchantables, c’est l’idéologie qui s’impose.
Une requête de 2023
Le Conseil d’État est une instance fort occupée. Il faut à ses décisions le long temps de la réflexion, et tant pis si elles tombent un jour de canicule au plein milieu des vacances d’été.
Cette « affaire » du point médian éclate au printemps 2022, quand l’association La France en partage saisit « plusieurs entités publiques, des universités, comme l’université de Rennes 2, des villes, comme la ville de Grenoble, aux fins de leur demander de retirer l’usage de l’écriture inclusive de leur communication institutionnelle ». Cela contrevient doublement à la loi. Une circulaire en date du 21 novembre 2017 stipule en effet l’interdiction de l'écriture inclusive dans les textes officiels. Un recours contre cette circulaire est alors déposé devant le Conseil d’État par l'association Groupement d'information et de soutien sur les questions sexuées et sexuelles, mais ce recours est rejeté le 28 février 2019, confirmant ainsi que l'écriture inclusive ne s'applique pas aux textes officiels.
La chose semble donc entendue : l’écriture inclusive est interdite dans la fonction publique. Toutefois, comme le souligne le site avocats.net, « la situation s’avère bien plus délicate pour les autres personnes publiques, d’autant que des jurisprudences du TA (tribunal administratif) de Paris et du TA de Grenoble pourraient être présentées comme contradictoire à première vue… et beaucoup moins quand y regarde de près. Et ce, au fil de débats juridiques subtils. »
Subtiles, on peut le dire, et contradictoires sont les décisions rendues suite aux requêtes déposées en 2023 par La France en partage après avoir constaté, notamment, que les statuts de l’université de Grenoble étaient rédigés en écriture inclusive et que divers établissements universitaires, dont Lyon 2, distribuaient des sujets d’examen en écriture non binaire.
Le Conseil d’État, qui rend son verdict sur cette affaire en décembre 2024, déclare finalement que les autorités administratives font comme elles veulent. Traduction des juristes cités plus haut : « L’administration peut donc refuser de passer à l’écriture inclusive et elle peut l’imposer dans ses services publics. Mais, inversement, peut-elle décider de l’adopter ? Le TA de Paris dit que… OUI en 2023 comme en décembre 2024. Celui de Grenoble répond que NON. Fol qui s’y fie ».
Le problème, c'est le costume-cravate
Espérant apporter un peu de clarté aux Français déboussolés, Le Figaro se tourne alors vers l’autorité compétente : Sylvie Retailleau, alors ministre de l’Enseignement supérieur. Interrogée par le quotidien sur la question de savoir si « l’écriture inclusive, et plus globalement l’usage du français, est une problématique à laquelle est confronté l’enseignement supérieur », la dame botte en touche. Elle répond sexisme, plafond de verre, et dénonce « la légitimité naturelle du costume-cravate », en conséquence de quoi elle « veille à privilégier l’usage d’une expression inclusive, [qu'elle] différencie de l’écriture dite inclusive utilisant le point médian ». C’est une adepte du celles-z-et-ceux.
Bien sûr, il faut, dit-elle, que la circulaire de 2017 soit respectée car « cela permet que les textes statutaires, officiels, des établissements soient lisibles et compréhensibles ». Toutefois, « du côté des enseignants et des contenus pédagogiques cependant, c’est la liberté académique qui prime, un principe auquel [elle est] bien sûr très attachée ». Et d’insister : « Nous ne remettrons jamais en cause la liberté académique. Il faut respecter cette autonomie, nous ne pouvons avoir que des recommandations ». Bref, circulez, y a rien à voir !
C’est cette reculade qui a motivé l’association La France en partage à poursuivre sa croisade et saisir le Conseil d’État. Elle dénonce « l'usage du point médian ainsi que celui des mots relevant de l'écriture dite "inclusive" dans l'énoncé des sujets d'examen et dans l'ensemble des documents et communications des établissements d'enseignement supérieur » ainsi que « la décision de la ministre de ne pas interdire cet usage, révélée par les propos qu'elle a tenus lors d'un entretien publié dans un quotidien national le 25 mai 2023 » (cf. l’article du Figaro).
Hélas – mais qui s’en étonnera –, la décision qui vient d’être rendue est d’une remarquable hypocrisie. En effet, l’argument des « sages » est que : 1) rien n’obligeait la ministre à prendre une décision ; 2) le fait qu’elle n’en ait pas pris « ne révèle aucune décision de refus de proscrire l'usage de l'écriture dite " inclusive" dans les documents officiels des établissements d'enseignement supérieur, ni dans les supports pédagogiques utilisés dans l'enseignement supérieur ». Et, donc, « par suite, il n'en résulte aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ».
Comme l’écrit le syndicat étudiant UNI dans son post déplorant cette décision : « Une écriture woke avec des règles floues, incohérentes et qui complexifient le français n’a pas lieu d’être dans nos lieux d’enseignement. » L’affaire n’est pas close et « l’UNI continuera de se battre pour la préservation de la langue française ».
- Source : Boulevard Voltaire