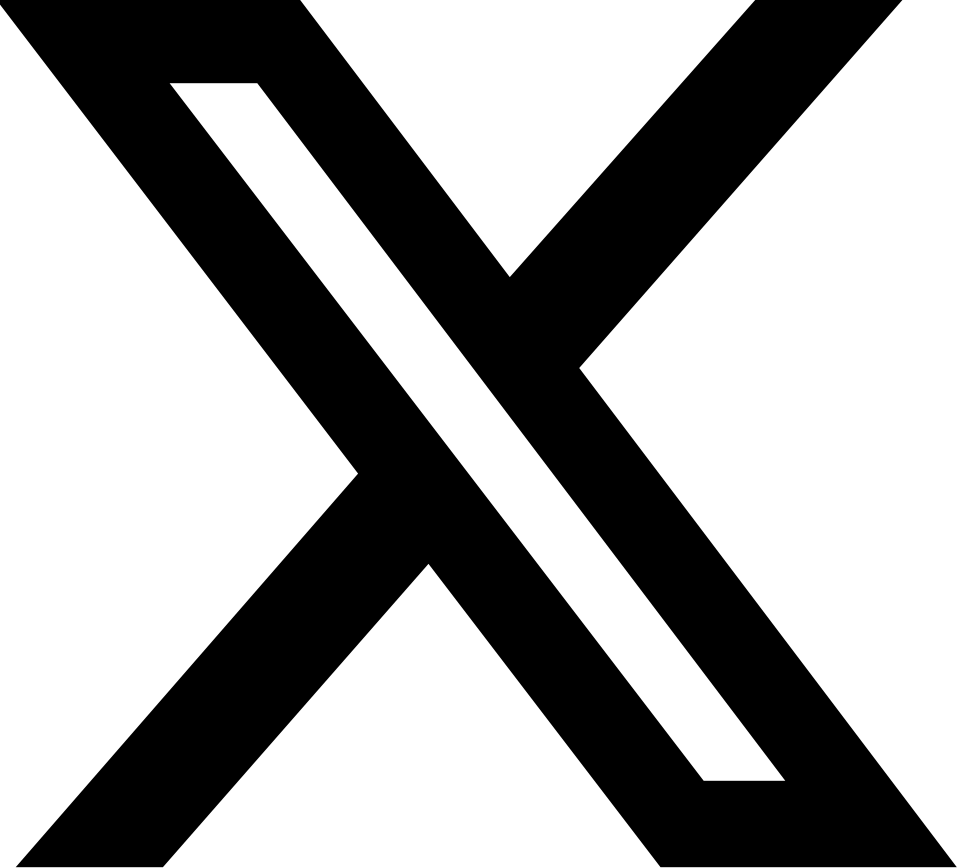État d’urgence sanitaire : comment l’administration a remplacé le politique

Chassez le naturel, il revient au galop. Seulement trois mois après avoir été levé, l’État d’urgence sanitaire est à nouveau en vigueur depuis ce samedi sur l’ensemble du territoire national.
Le nouveau régime permet de possibles confinements partiels, des réquisitions de véhicules et de bâtiments privés tels que des taxis ou des hôtels ainsi que la mise en place d’un contrôle des prix, soit un bond en arrière de 34 ans pour l’économie française qui s’était semble-t-il débarrassée de cette triste maladie économique.
Si la situation est officiellement exceptionnelle, l’histoire récente a montré que les situations d’exception ont une fâcheuse tendance à entrer dans le droit commun.
De quoi laisser songeur quant à un possible retour à la normale, rendu d’autant plus improbable qu’en France, le politique semble avoir cédé la place à l’administration.
À cela s’ajoute l’imbroglio administratif que connaît le pays, une nouvelle fois révélé par la crise sanitaire, ainsi qu’une tendance gouvernementale à prendre de plus en plus de libertés avec l’État de droit.
Trois phénomènes qui contribuent aujourd’hui à faire péricliter un peu plus l’esprit démocratique dans ce pays.
L’énarchie au sommet de l’État
L’ENA est-elle la panacée lorsqu’on prétend à des fonctions politiques ? Si la réponse est malheureusement évidente, Dominique de Villepin a lui-même vendu la mèche lors d’un passage chez Laurent Ruquier en 2010.
Justifiant politiquement son aversion notoire pour Nicolas Sarkozy, l’ancien Premier ministre estimait que l’exécutif de l’époque ne savait pas ce qu’étaient les affaires de l’État. La raison évoquée était que le couple exécutif était uniquement composé de juristes et non d’énarques.
Difficile de ne pas mettre cette pique en parallèle avec la formation des deux présidents de la République qui ont suivi, qu’il s’agisse de François Hollande ou d’Emmanuel Macron, pour lequel l’ex-bras droit de Jacques Chirac a par ailleurs déclaré avoir voté.
Aujourd’hui, la composition de l’exécutif est particulièrement claire.
Si les gouvernements qui se sont succédé durant le mandat de François Hollande et les deux gouvernements Philippe ont compté peu d’énarques comparativement à d’autres, l’équipe formée autour de Jean Castex redonne un poids certain à la haute-administration dans la vie politique nationale. Sur les 16 ministres du premier gouvernement Castex se trouvent ainsi près de 6 énarques.
Seulement, un ministre n’est pas un haut-fonctionnaire, ni un simple administrateur, mais une personnalité politique. Si la plupart des juristes s’accordent à dire qu’il existe une porosité entre ce qui relève du politique et ce qui relève de l’administration, la distinction est claire : le politique définit des objectifs que l’administration réalise.
Le ministre change, l’administration reste
C’est donc là que l’administration s’arrête, avec pour principale ligne de crête les cabinets ministériels qui peuvent avoir en leur sein des personnalités plus éclectiques que les services de l’État.
Ainsi, l’administration ne décide pas. Elle exécute. Or, les gouvernements mis en place depuis 2017 voire 2012 montrent que les personnalités politiques se sont effacées au profit de la Haute fonction publique.
Ensuite, même si les ministres changent, l’administration, généralement, demeure, et de nombreuses enquêtes journalistiques ne manquent pas d’en souligner l’importance. Pour ne citer que Dans l’enfer de Bercy, de Frédéric Says, cette différence de durée de vie entre les ministres et leurs administrations pose un certain nombre de problèmes.
En France, depuis 1958, un ministre reste à son poste moins de deux ans en moyenne. Cette différence, ajoutée à la technicité des dossiers que le ministre est amené à gérer, crée un filtrage entre la mesure souhaitée par le ministre et le texte sorti des bureaux, à la manière d’un tamis.
Les crises ont une tendance à renforcer ces dynamiques.
L’administration comme refuge du pouvoir
Si historiquement, la peur a toujours favorisé l’émergence de chefs charismatiques, qu’en est-il lorsque ce dernier est lui-même frappé de frilosité ?
Loin d’être théorique, cette question se pose de plus en plus lorsqu’on constate le comportement d’Emmanuel Macron au regard de la crise sanitaire, comme lorsqu’il retrouvait ses réflexes idéologiques.
Ainsi, au moment où la perspective d’un confinement commençait à se poser et que les avis ont divergé à la tête de l’exécutif, Édouard Philippe s’est montré plus sensible au maintien de la vie économique et sociale, tandis que le président de la République privilégiait la fermeture, avec les résultats que nous connaissons. Par cette mésentente, chacun retrouvait sa position au sein d’un clivage politique qu’ils s’étaient pourtant employés à gommer.
Si c’est bel et bien dans l’adversité que les hommes révèlent leur vraie nature, celle de Emmanuel Macron s’est particulièrement bien révélée ces derniers mois. Le politique s’est ainsi effacé au profit de l’administration.
Déresponsabilisation du politique
Dans le cas du Covid-19, le galimatias décisionnel français composé d’une myriade d’agences et d’administrations créées pour conseiller le souverain a tristement rappelé leur perniciosité.
Les défenseurs de la liberté portent en eux un concept administratif très simple et pourtant très peu appliqué : la subsidiarité.
Théorisée par la pensée chrétienne et formalisée par le philosophe Johannes Althusius, la subsidiarité se base sur un principe simple voulant que chaque décision doive être prise au niveau qui lui est le plus adapté.
L’objectif était donc ici de définir quel échelon est responsable de telle décision, tel problème ou plus largement de tel domaine.
Très mal comprise en France où l’on évoque souvent le concept pour justifier des suppressions d’échelons administratifs au nom de la lutte contre le fameux millefeuilles administratif, la subsidiarité suggère au contraire une diversité des niveaux de décision afin de s’adapter au mieux à la diversité des situations. Les régions, départements ou communes ont tous leur place.
Le problème tient dans ce que nous pouvons appeler « un millefeuilles horizontal », composé des différents organismes et agences prenant part à la décision publique. En effet, ces dernières entraînent lenteur, désorganisation et surtout déresponsabilisation du politique au profit des structures administratives.
Ainsi, outre le défaut d’anticipation lié à la polémique sur les vaccins lors de l’épidémie de H1N1 et la relégation en second plan de la question sanitaire au profit du risque terroriste, le fameux rapport Pittet sur la gestion française de la crise sanitaire remis la semaine dernière pointe du doigt la complexité de l’organisation administrative française, que l’épidémiologiste genevois n’hésite pas à qualifier de « labyrinthe ».
Le résultat est sans appel : à l’efficacité du système décentralisé allemand qui a su isoler plus rapidement et plus efficacement les différents foyers de contamination, l’imbroglio français a fait perdre énormément de temps et d’énergie dans la lutte contre le virus.
On décide d’abord, on régularise ensuite
Enfin, dans le cas de l’État d’urgence sanitaire, la manière employée par l’exécutif suit une mécanique particulière : on crée le consensus politique, on prend la décision, et l’on ne régularise juridiquement qu’a posteriori.
C’est ainsi que les mesures prises avant la loi du 23 mars 2020 sur l’État d’urgence sanitaire ont suscité de nombreuses interrogations, notamment à travers le décret du 16 mars 2020 instaurant le confinement.
Ce décret, et en particulier la question de coordination entre les mesures sécuritaires et sanitaires, que ce soit nationalement ou localement, a été considéré comme illégal par certains juristes, même si ces derniers s’accordent sur le fait que ces mesures peuvent être justifiées par la théorie des circonstances exceptionnelles, déjà invoquée lors des deux conflits mondiaux et ce jusqu’aux différentes lois qui les ont depuis régularisées.
Cette manière de procéder n’est pas sans rappeler deux événements fondateurs de notre régime politique.
D’une part, la création de la Cinquième République, sur laquelle plusieurs juristes avaient émis des doutes sur sa constitutionnalité. Ils rappelaient que la Quatrième République ne pouvait être modifiée par référendum et que la procédure opérée par le général de Gaulle était inconstitutionnelle.
D’autre part, le référendum de 1962 sur l’élection du président de la République au suffrage universel direct, convoqué non par l’article 89 initialement prévu pour modifier la Constitution, mais par l’article 11, prévu initialement pour questionner sur une loi. Saisi par le président du Sénat de l’époque, le Guyanais Gaston Monnerville, le Conseil constitutionnel s’était finalement déclaré incompétent pour juger une loi référendaire.
Pour cause, en 1962 comme en 1958, ces écarts ont été régularisés par « le droit souverain du peuple à disposer de lui-même ». En vertu de sa qualité de souverain en dernier ressort, le peuple tranchait et les institutions s’y soumettaient.
Si cette manière d’agir est donc le propre des grandes crises, la différence principale avec la situation actuelle tient dans le mode de régularisation qui, en 1958 comme en 1962, passait par un vote direct du peuple.
Une carence démocratique
La France n’a pas connu de référendum national depuis maintenant plus de 15 ans. Depuis 1958, cet écart n’a été dépassé qu’une seule fois : entre celui portant sur l’entrée du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Danemark et de la Norvège dans la CEE en avril 1972 et celui portant sur l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en novembre 1988, soit un peu plus de 16 ans et demi sans consultation nationale.
Or, le manque de consultation des citoyens pose un véritable problème démocratique, en particulier dans un contexte de doute économique, social, identitaire et désormais sanitaire où le pouvoir retrouve sa vieille tentation liberticide.
Une situation qui n’est pas près de s’arrêter, alors que les scrutins régionaux et départementaux pourraient connaître un report, que ce soit pour des raisons sanitaires ou de purs faits du Prince.
- Source : Contrepoints