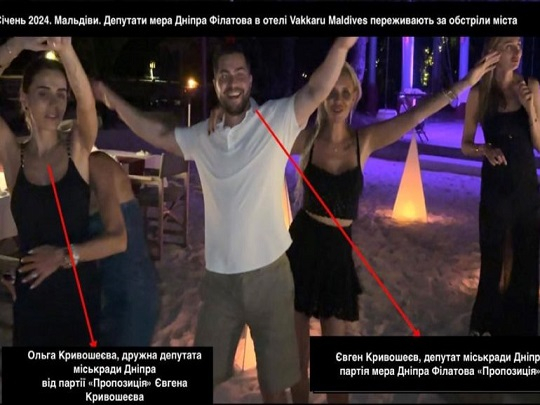Servitude volontaire de la presse (et de l’État) face aux géants du numérique

L’information est publique mais peu connue : Amazon, le site de e-commerce, et le quotidien américain le Washington Post ont le même patron, Jeff Bezos. Le fondateur d’Amazon a en effet racheté le titre en octobre 2013. Avec une promesse : augmenter le lectorat du quotidien, alors en baisse.
Ce rachat d’un journal par un oligarque du numérique illustre une tendance actuelle : depuis quelques années, des acteurs comme Google, Apple, Facebook et Amazon (dits les « GAFA ») investissent fortement, directement ou indirectement, dans la presse.
Problématiques en soi pour la liberté de la presse, de tels investissements ne sont par ailleurs pas sans effets sur les revenus des journaux, la façon dont ils produisent l’information et la qualité de cette production. Un constat d’autant plus consternant qu’une grande partie de la presse française, manifestement aux abois, fait preuve de servitude volontaire face aux géants du numérique.
Un journalisme pensé pour Google, Facebook et Snapchat
Il y a encore quelques mois, l’utilisation des réseaux sociaux par les médias français pouvait se résumer, à gros traits, à un relais de leurs articles sur Facebook, Twitter et d’autres réseaux sociaux moins connus. Le lecteur voyait alors s’afficher des articles sur ses flux personnels et, quand il cliquait sur l’un d’entre eux, était renvoyé vers les sites de presse concernés : lemonde.fr, lepoint.fr, etc. Les réseaux sociaux étaient alors de simple tremplins vers les sites internet des journaux.
Aujourd’hui, ces réseaux sociaux deviennent des espaces de publication : les journaux y publient directement leurs contenus. Plutôt que de publier leurs contenus journalistiques seulement sur leurs sites Internet, les journaux les publient aussi sur des espaces de publication créés par les grands acteurs du numérique : « Discover » de Snapchat, « Instant articles » de Facebook, « AMP » de Google, etc. L’argument avancé par ces oligarques du numérique : conquérir des audiences nouvelles. Un argument auquel les titres de presse écrite ne peuvent être insensibles étant donné la raréfaction du lectorat.
Certains titres de presse se disent d’ailleurs plutôt satisfaits de ce que proposent les géants du numérique. C’est le cas par exemple de Libération qui, après avoir essayé la fonctionnalité « Instant articles » de Facebook, déclare en tirer un bilan positif : un temps de lecture plus long et des revenus par page plus importants, en raison de l’espace accru pour accueillir des publicités.
Alors, tout va bien ? À voir : s’il y a des gains (très ponctuels et intégralement dépendants du bon vouloir des acteurs du numérique), c’est précisément parce que des moyens humains et financiers sont mobilisés pour utiliser ces nouveaux outils (qui nécessitent du temps pour être appréhendés et correctement utilisés). Autant de moyens non investis dans… le journalisme (plus précisément : la fabrication de l’information). Impossible de reprocher à un titre d’aller chercher son lectorat où il pense qu’il se trouve, mais à l’ère de la « réduction des dépenses » et des nombreuses destructions de postes de journalistes, la question se pose en ces termes : Libération a-t-il intérêt à mobiliser des salariés pour être plus vu sur Facebook… ou pour produire de l’information ?
Un journalisme dépendant du bon vouloir des oligarques du numérique
Ce premier problème en soulève un autre, autrement plus important : en publiant leurs articles directement chez les « GAFA » (Google, Amazon, Facebook, Apple), les journaux se dépossèdent eux-mêmes de la propriété de leur production. Facebook, comme Google et Snapchat, sont en effet souverains sur leurs espaces. Ce qui signifie que contrairement à un site Internet (lemonde.fr, lefigaro.fr…), où les journaux font absolument ce qu’ils souhaitent avec leurs articles, les espaces de publication des réseaux sociaux (Snapchat, Facebook…) et des moteurs de recherche (Google…) sont « prêtés » aux journaux. La presse devient donc dépendante des conditions que leur imposent les oligarques du numérique.
Une dépendance qui a des conséquences concrètes. Certains y ont en effet déjà perdu des plumes : c’est le cas par exemple du site Yahoo ! qui a vu sa chaîne sur « Discover » (Snapchat) fermée du jour au lendemain par la seule décision du directeur de Snapchat. Raison invoquée : le contenu publié n’était pas digne des standards de qualité souhaités par le réseau social. Quand on sait qu’un autre titre, le Wall Street Journal, consacrait, au début de l’année 2016, cinq personnes à temps plein à sa chaîne « Discover » et que sept salariés du journal Le Monde travaillent pour le format de Snapchat, on mesure le poids (financier et humain) que peut avoir une telle décision sur une rédaction.
Les sites de presse dépouillés de leurs revenus publicitaires
Un autre argument mobilisé par les réseaux sociaux et moteurs de recherche pour séduire la presse est l’augmentation des revenus publicitaires. La logique paraît imparable : grâce à l’accroissement du lectorat permis par ces nouveaux espaces de publication (Facebook revendique par exemple plus d’1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde), les entreprises désireuses de recourir à la publicité dans les journaux achèteront plus d’espace de publicité à ces derniers, et ces espaces seront vendus plus cher puisque le lectorat des journaux aura fortement augmenté. In fine, les titres de presse bénéficieront d’une augmentation mécanique des revenus issus de la publicité.
Séduisante en théorie, cette belle mécanique tait pourtant un point important : le lectorat acquis sur les espaces de publication des réseaux sociaux reviendra-t-il sur les sites Internet des journaux ? Autrement dit : où est la garantie qu’un lecteur consultant Le Monde sur Snapchat continuera de se rendre sur le site Internet du quotidien ?
Cette perte potentielle de lecteurs pour les sites Internet de presse pourrait avoir une conséquence directe : moins de revenus pour ces journaux. Car qui dit moins de visiteurs dit des publicités moins rémunératrices pour les journaux (puisque les entreprises paient ces publicités en fonction, entre autres, de la quantité des visiteurs sur les sites ciblés). Ce constat est d’autant plus cruel que cette probable perte de revenus publicitaires se fait au profit des Facebook, Snapchat et Google, entre autres.
Les acteurs du numérique, rentiers de l’information produite par les journaux
Réseaux sociaux et moteurs de recherche captent en effet tout ou partie des revenus publicitaires qui s’échappent de la presse puisque les audiences de cette dernière sont partiellement transférées vers ces réseaux sociaux. En transférant ses articles sur l’espace de publication de Facebook (« Instant articles »), le quotidien Libération provoque de fait un déplacement d’audience de son site vers le réseau social américain : plutôt que de trouver l’article sur Facebook et d’être redirigé vers le site Internet liberation.fr, l’internaute lit directement cet article sur Facebook, sans quitter le réseau social… et sans jamais mettre un pied sur le site de Libération.
Certes, Facebook promettait, au lancement des « Instant articles », que 100 % des revenus publicitaires reviendraient aux journaux lorsque ceux-ci administrent la gestion des publicités eux-mêmes. Rien n’indique cependant que ce sera toujours le cas puisque le réseau social peut décider du jour au lendemain un changement de politique beaucoup moins favorable aux titres de presse. Et lorsque la majorité des journaux aura cédé en basculant l’ensemble de sa production chez Facebook, pourquoi le réseau social se priverait-il de revoir ses conditions afin de toucher sa part – sans aucune contribution aux coûts de production ? Le pire n’est jamais certain, pourra-t-on nous objecter, mais la situation asymétrique ainsi créée développe les conditions d’une soumission de plus en plus forte des organes de presse à la firme de Mark Zuckerberg, peu connue pour sa philanthropie.
Car l’intérêt, pour le géant californien, n’est pas tant d’aider gracieusement la presse que de garder les internautes sur son espace – la vraie valeur du réseau social étant mesurée par le temps qu’y passent les internautes. Ainsi, le fait que les journaux livrent directement leurs contenus sur Facebook, fournissant dès lors une raison de plus aux internautes pour passer plus de temps sur le réseau social, est une victoire pour ce dernier. Pour la presse, ce sera probablement une autre histoire le jour où Facebook décidera d’un régime moins favorable à ses « locataires » – puisque c’est ce que deviennent de fait les titres de presse qui utilisent les « articles instantanés » de Facebook.
Et même dans le meilleur des cas, à savoir que les lecteurs continuent d’aller sur les sites Internet des journaux malgré les facilités de lecture apportées par certains réseaux sociaux, les titres de presse peuvent quand même y perdre des plumes. Ainsi, Google, par le biais de sa fonctionnalité « AMP » qui offre un temps de chargement des pages web plus rapide sur les téléphones mobiles, s’arrange pour capter une partie des revenus publicitaires générés par l’audience des articles produits par les journalistes. Pour une raison simple : si les médias veulent utiliser cette fonctionnalité de Google et ajouter des publicités sur ces pages, ils sont fortement incités à passer par la régie publicitaire… de Google. Une régie qui prélève évidemment une commission sur chaque publicité.
Quand les éditeurs de presse européens assumaient le conflit face à Google
Avant que ne se mette en place ce qu’il faut bien appeler une servitude volontaire des médias dominants face aux acteurs du numérique, certains éditeurs avaient bien tenté de réagir. Un bras de fer qui a obligé Google à distribuer quelques aides financières à la presse afin de clôturer un conflit dont les sources sont pourtant toujours bien présentes.
Depuis 2013, l’entreprise américaine finance ainsi des « projets destinés à accroître l’audience et la monétisation des sites d’informations générales et politiques » de la presse française ; un financement à hauteur de 60 millions d’euros, ventilé par candidats et projets. Philanthropie ? C’est ce que souhaiterait faire croire Google, mais en réalité on trouve, à l’origine de ces aides, le conflit évoqué précédemment entre Google et la presse européenne.
« Google actualités », le moteur de Google dédié aux informations, était alors accusé d’une part de violer la propriété intellectuelle des journaux et, d’autre part, de « voler » le travail des journalistes. Concrètement, les principaux organes de presse reprochaient à Google de profiter de leurs articles pour acquérir de l’audience sans payer, en retour, ce que coûte la production desdits articles. Sans compter que les internautes étaient moins incités à se rendre sur les sites internet des journaux puisqu’ils pouvaient lire des résumés d’articles directement sur « Google actualités », provoquant une chute de revenus pour les éditeurs de presse.
Victoire totale de Google
Ce conflit s’était alors soldé par une victoire totale de Google, notamment en Espagne, en Allemagne et en Belgique, où des groupes d’éditeurs de presse avaient engagé un rapport de forces contre le moteur de recherche américain mais avaient reculé devant les mesures de rétorsion de Google. La firme a usé de diverses menaces, du déréférencement de certains titres de presse possédés par des éditeurs trop vindicatifs, à l’interruption totale de ses services. En France, c’est donc dans un contexte de défiance de la presse envers le moteur de recherche que ce dernier a annoncé sa politique d’aide, avec la bénédiction, au moins tacite, d’un gouvernement Ayrault trop heureux de soulager l’État de sa mission d’aides à la presse au profit de Google. Des aides qui ont produit le résultat souhaité : depuis leur lancement, le conflit entre Google et les éditeurs de presse s’est éteint.
Pourtant, rien n’est réglé. Pire : inévitablement, les titres de presse aidés par Google seront moins enclins à critiquer le moteur de recherche ou à enquêter sur lui – même s’ils s’en défendront. Surtout, « Google actualités » continue de profiter à plein des contenus de presse. Ainsi, en échange de 60 millions d’euros – une somme dérisoire si on la compare au chiffre d’affaire de Google, évalué à 75 milliards d’euros en 2015 – le moteur de recherche peut continuer à utiliser des contenus journalistiques pour faire d’énormes profits financiers, sans aucune contribution substantielle aux coûts de la fabrication de l’information.
Abonnez-vous à SFR et recevez (une cafetière) un accès à Libération
Enfin, dans les relations entre journaux et géants du numérique, il est un autre type d’acteur que l’on se doit d’évoquer : les « FAI », fournisseurs d’accès à Internet (Orange, Free, SFR…). L’aspect le plus spectaculaire, dans ce domaine, est le rachat de certains journaux par ces « FAI », comme Free, par l’intermédiaire de son directeur Xavier Niel, qui possède avec MM. Bergé et Pigasse le groupe Le Monde (L’Obs, Télérama, Le Monde, Courrier international…), et SFR, par l’intermédiaire de Patrick Drahi, qui possède le groupe L’Express et le titre Libération.
Peut-être moins connue, la technique qui consiste à déverser des contenus de presse dans les « tuyaux » (les abonnements qui permettent un accès à Internet) n’en est pas moins redoutable pour les journaux possédés par ces « FAI ». Pour ces derniers, la stratégie est simple : offrir un « plus » à leurs abonnés afin de se différencier de la concurrence. C’est le cas, par exemple, de SFR, qui propose à ses abonnés un accès gratuit aux titres de presse qu’il possède. La version numérique de Libération est par exemple fournie gratuitement aux abonnés SFR.
C’est ainsi que les journaux qui offraient, il y a encore quelques mois, une cafetière ou un radio-réveil pour inciter les lecteurs à s’abonner, deviennent maintenant eux-mêmes le cadeau pour motiver les internautes à s’abonner aux fournisseurs d’accès à Internet. Un renversement de tendance qui donne une idée de la considération que peuvent avoir les oligarques du numérique pour la presse – à savoir autant que cette dernière pouvait avoir pour les cafetières ou radio-réveils.
L’illusion « SFR presse » qui devait amener des millions de lecteurs à Libération
À l’instar des réseaux sociaux et des moteurs de recherche, les fournisseurs d’accès à Internet avançaient eux aussi, pour faire avaler la pilule, l’argument d’une augmentation du lectorat pour les journaux. Au moment du rachat de Libération puis du groupe « L’Express », Patrick Drahi répétait ainsi à quel point ces titres allaient profiter des millions d’abonnés SFR qui allaient, par l’intermédiaire de l’application mobile « SFR presse », accéder gratuitement à leurs articles. In fine, ce surcroît de lectorat allait provoquer une augmentation du prix des publicités, donc une augmentation des revenus pour ces titres. Un air de déjà vu.
L’illusion n’aura pas duré : en juin 2016, 300 000 internautes seulement avaient téléchargé l’application « SFR presse » (à comparer aux 18 millions de clients de SFR). Pire : l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (APCM – anciennement « OJD ») a considéré que seule une infime partie des téléchargements de journaux par les utilisateurs de l’application « SFR presse » pouvaient être comptabilisés comme lecteurs réels, c’est-à-dire au même titre qu’un lecteur achetant Libération au kiosque ou le lisant sur liberation.fr. C’est ainsi que les millions de lecteurs supplémentaires promis sont réduits finalement à quelques milliers par l’APCM. Or, les tarifs des publicités sont négociés à partir des chiffres fournis par cet organisme.
Malgré la promesse de Patrick Drahi, Libération et les autres titres possédés par Altice n’auront eu ni lectorat supplémentaire ni augmentation des revenus. En revanche, les départs de journalistes ont été bien réels : par la volonté de Patrick Drahi, Libération a perdu 69 postes et L’Express s’est « séparé » de 26 journalistes (sur 66). Dans les deux cas, cela représentait un tiers des effectifs de chacun des deux titres.
***
Quand Patrick Drahi a annoncé vouloir se séparer d’un tiers des effectifs de Libération, Laurent Joffrin, directeur de la rédaction, a abondé : « Libération perdait 9 millions d’euros, pour un chiffre d’affaire de 40 millions. Que ce soit Drahi, Durand, Dupont ou Tartempion, vous êtes bien obligé de redimensionner votre outil de production. » Une servitude volontaire qui ne surprend pas venant de Laurent Joffrin, pas plus que lorsqu’elle vient de Christophe Barbier, qui s’était fait un parfait zélote des promesses de Drahi auprès de la rédaction de L’Express. On a vu ce que ces promesses sont devenues.
S’agissant des espaces de publication des réseaux sociaux et des moteurs de recherche, la même servitude volontaire est à l’œuvre. Que ce soit à Slate, à Libération, aux Échos ou encore au Parisien, on tient un discours très positif sur ces outils.
Ainsi, que ce soit face aux fournisseurs d’accès à Internet ou aux réseaux sociaux, une partie de la presse, financièrement aux abois, réalise des choix délétères qui l’amène à perdre sa souveraineté sur la production journalistique et à être dépouillée de ses revenus publicitaires.
Notons enfin que l’État porte aussi une lourde responsabilité dans cette situation : si la presse française opère de tels choix, c’est probablement aussi par réflexe de survie face à l’inaction de la puissance publique. Alors que, pour ne prendre qu’un exemple, les aides à la presse se distinguent par leur absurdité, il aura fallu que des salariés de Charlie Hebdo soient assassinés en janvier 2015 pour que le gouvernement socialiste réoriente timidement ces aides. L’absence de réaction des gouvernements face aux pratiques des acteurs du numérique n’est donc pas une surprise. Chemin faisant, le journalisme est devenu pour ces géants ce qu’était la cafetière ou le radio-réveil pour Télérama hier : un simple faire-valoir.
- Source : Acrimed