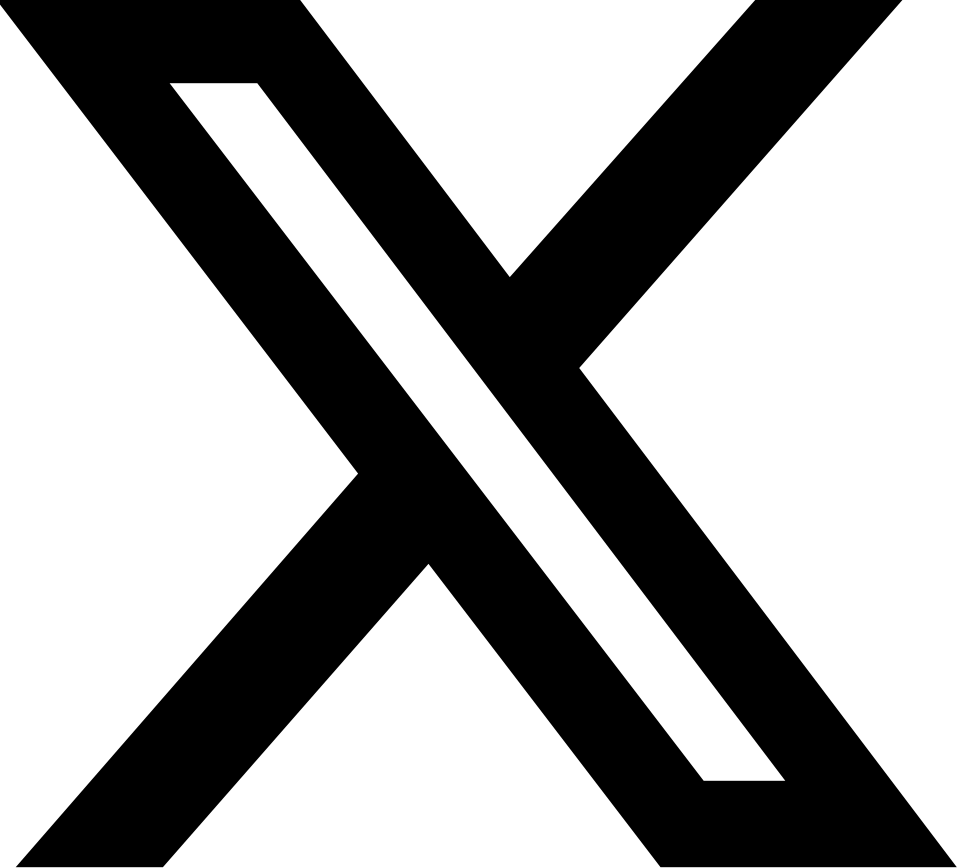À Gaza, Israël détruit méthodiquement le système de santé

Cet article, quoique insoutenable, donne un visage et une dignité aux Palestiniens, victimes de l’armée d’occupation génocidaire, quand nos médias les réduisent à de simples «statistiques du Hamas» anonymes. Le tableau dressé ici, aussi horrible et apocalyptique soit-il, n’est qu’un modeste aperçu des souffrances quotidiennes qu’endure tout un peuple pris au piège, et constitue une tache indélébile pour l’humanité.
Alain Marshal
*
Dans les hôpitaux dévastés de Gaza, des patients qui pourraient être soignés sont condamnés à «une mort lente et silencieuse»
Ils se vident de leur sang à cause de blessures modérées causées par des éclats d’obus. Ils meurent de maladies que les médecins n’ont pas le temps de traiter. Ils deviennent aveugles en attendant une évacuation médicale à l’étranger. Voilà les multiples victimes de la guerre d’Israël contre le système de santé de Gaza.

Des Palestiniens blessés s’entassent sur les sols de l’hôpital Nasser après le bombardement d’une zone résidentielle située près d’une école abritant un grand nombre de personnes déplacées, à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 3 décembre 2023.
Ces derniers jours, des détails ont émergé au sujet d’un massacre israélien particulièrement atroce visant des équipes médicales palestiniennes dans le sud de la bande de Gaza. Le 23 mars, une équipe du Croissant-Rouge et de la Défense civile a été envoyée en mission pour secourir des collègues qui avaient été pris pour cible plus tôt dans la journée dans le gouvernorat de Rafah. À un moment donné, le contact avec l’équipe a été perdu, et ses membres ont été présumés morts.
Mais ce n’est que plusieurs jours plus tard, lorsque des équipes conjointes du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), du Croissant-Rouge et de la Défense civile ont pu accéder au site et l’exhumer, que toute l’horreur a été révélée : mains et pieds attachés avec des liens zip, signes d’exécution à bout portant, et corps mutilés au point d’être méconnaissables. Il ne s’agissait pas de victimes de tirs croisés. Les forces israéliennes les avaient exécutés de sang-froid [ce qui constitue un crime de guerre], avant d’utiliser un bulldozer pour enterrer leurs véhicules écrasés sur leurs corps.
«Nous les déterrons encore en uniforme, avec leurs gants», a déclaré Jonathan Whittall de l’OCHA, après la découverte de la fosse commune à Tel Al-Sultan. «L’un d’eux a été déshabillé, un autre décapité», a précisé Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile.

Selon le bureau des médias de Gaza, l’armée israélienne a tué 1402 travailleurs médicaux depuis le 7 octobre, faisant de cette campagne l’une des plus meurtrières de l’histoire moderne contre des personnels de santé. Le ciblage des soignants s’inscrit dans une offensive plus large contre les infrastructures de soins de Gaza : 34 hôpitaux ont été détruits et mis hors service, tout comme 240 centres de santé et 142 ambulances également pris pour cible. Le montant total des dommages subis par le secteur de la santé est estimé à plus de 3 milliards de dollars, rendant celui-ci totalement incapable de répondre aux besoins urgents d’une population prise au piège entre siège et bombardements [crime de guerre voire crime contre l’humanité].
Au cours de la guerre, les forces israéliennes ont également fait irruption dans de nombreux établissements médicaux, les transformant en avant-postes militaires [crime de guerre], comme l’a montré une récente enquête de Human Rights Watch. De grands hôpitaux, dont Al-Shifa et Nasser, ont non seulement été pris d’assaut, mais aussi occupés, mettant en danger patients et personnel, et entraînant la mort de malades déplacés de force ou laissés sans traitement.
Ces actions, combinées au blocus général et à la privation d’aide essentielle, traduisent une stratégie délibérée de démantèlement du système de santé de Gaza – une tactique pouvant s’apparenter à des crimes contre l’humanité, tout comme l’extermination et les actes de génocide.

Des blessés palestiniens jonchent le sol de l’hôpital Nasser après une frappe aérienne israélienne sur une zone résidentielle à proximité d’une école accueillant des Palestiniens déplacés, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 3 décembre 2023.
Lors du récent cessez-le-feu, les installations médicales de Gaza étaient déjà au bord de l’effondrement, mises à genoux par les conséquences de 15 mois d’attaques israéliennes continues. Mais avec la reprise de la campagne militaire d’Israël et le blocus total de l’enclave, les hôpitaux palestiniens de la bande de Gaza ont déclaré que le système de santé, déjà sinistré, était désormais en état de «mort clinique».
Le Dr Mohammed Zaqout, directeur général des hôpitaux de campagne du ministère de la Santé, a averti que la guerre israélienne en cours aggravait ce qu’il a qualifié de «crise humanitaire déjà insupportable». Il a souligné que la fermeture continue des points de passage par les forces israéliennes empêchait l’entrée de médicaments, d’équipements médicaux et de carburant, pourtant désespérément nécessaires.
Les scènes dans les hôpitaux de Gaza ne ressemblent plus à celles d’établissements de soins. Les patients sont étendus sur des sols maculés de sang, leurs blessures laissées sans traitement. Certains essaient désespérément de respirer à mesure que l’oxygène s’épuise ; d’autres restent allongés en silence, dans l’attente d’un soulagement qui ne viendra jamais. Le système de santé n’est pas seulement assiégé : il est démantelé de manière délibérée.
«Nos hôpitaux sont débordés, et nous manquons de tout», a déclaré le Dr Zaqout. «Il ne s’agit pas seulement de pénuries, mais d’une absence totale».
«Nous utilisons nos mains nues et des lampes de poche – c’est médiéval»
Ce qui était autrefois un réseau vital d’hôpitaux, de cliniques et de circuits de référence à Gaza a été réduit à un paysage fracturé de tentes de fortune, d’abris surpeuplés et d’unités improvisées. Ces installations sont souvent dépourvues d’électricité, d’eau potable ou de fournitures médicales de base. Les médecins restants, assiégés et pris pour cible en même temps que leurs patients, travaillent bien au-delà de leurs capacités humaines, n’ayant à disposition guère plus que de la gaze et de la détermination.
Pourtant, les équipes médicales continuent de faire tout leur possible pour aider leurs patients. «Nous n’avons pas le luxe de nous reposer», a déclaré à +972 le Dr Ahmed Khalil (pseudonyme), un médecin qui a passé les 540 derniers jours à circuler entre des hôpitaux bombardés. «Nous traitons les patients à même le sol, sans électricité, sans anesthésie. Nous utilisons nos mains nues et des lampes de poche – c’est médiéval».

Des Palestiniens se précipitent pour transporter les blessés, dont de nombreux enfants, à l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza, alors que les forces israéliennes continuent de pilonner la bande de Gaza, le 11 octobre 2023.
En mars 2024, les forces israéliennes ont encerclé et assiégé l’hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza – le plus grand établissement médical de l’enclave – pour la deuxième fois, coupant l’accès à la nourriture, au carburant et aux fournitures médicales. Piégé à l’intérieur pendant plusieurs jours, Khalil a vu l’hôpital se transformer d’un centre de soins animé en une cible militaire. «Nous étions encerclés par des chars, des drones bourdonnaient au-dessus de nos têtes, sans électricité, sans nourriture. Nous opérions à la lumière des téléphones portables», se souvient-il.
«Lorsque les machines à oxygène ont commencé à tomber en panne et que les moniteurs cardiaques se sont éteints, j’ai compris que nous n’étions plus dans un hôpital», a déclaré à +972 Amna, une infirmière de 32 ans qui travaille à Al-Shifa depuis environ dix ans. «Nous étions à l’intérieur d’un charnier en devenir».
Amna avait déjà vécu des guerres et des sièges, mais ce qui s’est passé ce mois-là, dit-elle, ne ressemblait à rien de ce qu’elle avait connu auparavant. «Ils étaient trop nombreux», se souvient-elle. «Nous avons dû faire des choix impossibles : qui traiter en premier, qui essayer de sauver, et qui laisser partir. Beaucoup sont morts non pas parce que leurs blessures étaient trop graves, mais parce qu’il n’y avait plus de machines, plus de place, plus de mains pour les aider».
Lorsque les forces israéliennes ont envahi Al-Shifa, Khalil – ainsi que les patients, le personnel et les civils déplacés – a été contraint d’évacuer sous les tirs. Son chemin vers le sud l’a mené à travers des quartiers rasés et des abris surpeuplés, jusqu’à l’hôpital Nasser, à Khan Younis, l’un des derniers centres médicaux encore partiellement fonctionnels de Gaza. Mais même là, les conditions étaient cauchemardesques.
«Les gens se vidaient de leur sang dans les couloirs», raconte-t-il. «Il n’y avait pas de morphine. Pas d’antibiotiques. Parfois, même pas de gaze». Les équipes médicales n’ont pas pu sauver de nombreux blessés qui attendaient d’être admis en soins intensifs. «J’ai vu des patients – des enfants, des personnes âgées – mourir en attendant une aide qui n’est jamais venue».
Un souvenir hante encore le Dr Khalil : celui d’un jeune homme d’une vingtaine d’années, blessé à l’abdomen par des éclats d’obus et transporté par ses proches sur un morceau de contreplaqué. «Nous n’avions ni imagerie, ni salle d’opération, ni antidouleur. Il est mort dans l’heure – non pas parce que nous ne savions pas comment le sauver, mais parce que nous n’avions rien pour le faire».

Des Palestiniens pleurent la mort de leurs proches à l’hôpital Al-Najjar, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 19 décembre 2023.
Les conditions que Khalil et ses collègues ont endurées seraient inimaginables dans n’importe quel autre contexte. «Nous avons opéré après 48 heures sans dormir», a-t-il déclaré. «Nous n’avons pas mangé – il n’y a pas de nourriture. Parfois, nous effectuons des gardes entières sans une goutte d’eau potable. Nous travaillons alors que nos propres familles sont déplacées ou enterrées. Parfois, nous soignons des patients en sachant qu’il n’y a aucun espoir – mais nous essayons quand même. Parce qu’il le faut».
Des bombes tombent à proximité pendant les opérations ; le vrombissement des drones et les cris des blessés résonnent dans les couloirs obscurs. «Nous ne faisons pas que traiter les traumatismes – nous les vivons», ajoute Khalil. «Nous sommes les blessés qui soignent les blessés. Mais nous refusons de laisser notre peuple mourir seul».
«Personne n’avait le temps pour quelqu’un qui ne saignait pas»
Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 50 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. Mais ces chiffres ne reflètent pas l’ampleur réelle de la crise : de nombreux autres décès auraient pu être évités si le système de santé de Gaza n’avait pas été démantelé pièce par pièce.
Le 2 mars 2025, Haithm Hasan Hajaj, ingénieur civil de 41 ans et père de trois enfants, est mort dans le nord de Gaza après avoir souffert pendant des mois d’une maladie pourtant curable – l’une des nombreuses morts silencieuses dans un système de santé détruit, où les besoins médicaux deviennent des demandes impossibles.
Sa femme, Mona, n’arrive toujours pas à s’y faire. «Il n’a pas été tué par une frappe aérienne. Il est mort lentement, en silence, parce que personne ne pouvait l’aider», confie la trentenaire à +972, la voix tremblante. «Pendant neuf mois, nous avons cherché de l’aide. Nous avons supplié pour obtenir un diagnostic, des médicaments, n’importe quoi. Mais il n’y avait rien».
Les symptômes de Hajaj ont commencé en juillet 2024 : douleurs abdominales soudaines, fatigue, anémie inexpliquée. «Au début, nous avons cru que c’était dû au stress de la guerre et à la faim», raconte Mona. «Mais au bout de quelques semaines, il tenait à peine debout. Nous sommes allés d’un endroit à l’autre, mais tous les hôpitaux étaient débordés. On nous disait : «Nous ne traitons que les blessures de guerre». Personne n’avait le temps pour quelqu’un qui ne saignait pas».

Des enfants palestiniens reçoivent des soins à l’hôpital Al-Awda après avoir été blessés lors d’une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 11 décembre 2024.
Piégés dans le nord sous blocus, ils n’avaient plus accès ni à des spécialistes ni à des laboratoires fonctionnels. «Un jour, nous sommes allés à l’hôpital baptiste», explique Mona. «Nous avons attendu de 6 heures du matin à 22 heures – seize heures de queue. Mais ils nous ont renvoyés. Le laboratoire n’avait plus de matériel. Ils ne pouvaient même pas faire une prise de sang».
Au fil des mois, l’état de Hajaj s’est dégradé. Sa peau s’est couverte d’éruptions douloureuses. Il a perdu 30 kilos. «En janvier, il n’était plus que peau et os. Mes enfants avaient peur de le toucher – non pas parce qu’ils avaient peur (de lui), mais parce qu’ils voyaient qu’il souffrait».
Enfin, au septième mois de son déclin, ils ont appris qu’il souffrait de la maladie cœliaque, une affection déclenchée par le gluten. La solution aurait dû être simple : supprimer le blé de son alimentation. Mais à Gaza, il n’y avait pas d’alternative. «Tout ce que nous avions, c’était du blé – et encore, il était rare», dit Mona. «Nous ne savions même pas. Pendant des mois, il a mangé ce qui le tuait à petit feu, juste pour survivre».
Deux mois plus tard, Hajaj est mort – non pas de la maladie cœliaque en elle-même, mais de l’absence de tout ce que Gaza ne pouvait plus offrir : outils de diagnostic, traitement, sécurité alimentaire, dignité [s’il est une chose dont le peuple de Gaza a à revendre, dans des quantités incommensurables sur toute la face de la Terre, sauf peut-être au Yémen, c’est bien de la dignité]. Leurs enfants, âgés de 9, 11 et 13 ans, posent aujourd’hui des questions auxquelles Mona ne sait pas répondre. «Ils n’arrêtent pas de demander quand Baba va revenir», dit-elle. «Le plus petit m’a dit : «On peut partager notre pain avec lui maintenant. Peut-être que ça lui fera du bien». Comment expliquer à un enfant que son père est mort parce qu’on n’a même pas pu trouver du pain qui ne lui ferait pas de mal ?»
Avant la guerre, Hajaj était sur le point de terminer son doctorat. «Il ne lui restait que quelques mois», raconte Mona. «Il avait des rêves. Il voulait enseigner. Il voulait construire quelque chose pour ce pays. Nous avions acheté une maison à Tel Al-Hawa un an avant la guerre. En novembre dernier, nous avons appris qu’elle avait été détruite par une frappe aérienne. Mais Haithm ne s’est pas plaint. Il a simplement dit : «On reconstruira – pour les enfants»». Elle s’interrompt, la gorge nouée. «Mais maintenant, il n’est plus là. Et je ne sais pas comment reconstruire sans lui. Comment vivre sans lui ?»
Leur fils de 13 ans, Hasan, essaie de prendre la place de son père. «Hasan veut être l’homme de la maison, aider son petit frère et sa petite sœur», explique Mona. «Hier, il est rentré de la rue en larmes, en sanglots, en disant : «Je veux mourir avec Baba. Je ne veux pas vivre comme ça». Il était parti chercher de la nourriture pour nous, mais il n’a pas pu en trouver. Ce n’est qu’un enfant. Il est terrorisé à l’idée de marcher seul dans la rue avec les bombes qui tombent. Il a besoin de son père – comme nous tous. Je ne sais pas comment leur redonner un sentiment de sécurité».

Des Palestiniens font le deuil de leurs proches à l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa après une frappe israélienne à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 9 janvier 2025.
Ce n’est pas seulement une question de médecine. C’est une question de dignité.
Pour Nabil Zafer, 64 ans (pour une parfaite transparence, il s’agit de l’oncle de l’auteur de cet article), la guerre n’a pas pris sa vie – mais elle lui a pris la vue, son autonomie, et son rôle de pourvoyeur pour une famille déjà en lutte pour sa survie.
Avant le début de la guerre, Zafer recevait un traitement régulier pour un glaucome sévère. Deux fois par semaine, il se rendait à l’hôpital pour recevoir des injections oculaires afin de gérer la pression et préserver ce qui lui restait de vision. Il devait également se rendre en Égypte en février 2024 pour une opération visant à poser des valves de drainage dans ses yeux – une procédure relativement simple qui aurait pu lui sauver la vue.
Mais à la fin de l’année 2023, alors que l’offensive israélienne s’intensifiait, l’accès aux injections oculaires à l’intérieur de la bande de Gaza est devenu quasiment impossible. Et en l’absence d’un système d’aiguillage fonctionnel, Zafer n’a pas pu sortir – il est l’un des plus de 10 000 Gazaouis dont les demandes d’évacuation médicale sont restées sans réponse durant la première année de guerre. «Les médecins nous ont dit : «S’il n’est pas opéré rapidement, il perdra la vue» – et il était déjà trop tard», raconte Hanan, son épouse, à +972.
«Au début, il voyait des ombres», poursuit cette femme de 58 ans. «Puis, tout est devenu flou. Jour après jour, nous l’avons vu perdre la vue. En novembre dernier, il était complètement aveugle».
La perte de sa vision a bouleversé chaque aspect de la vie de Zafer, avec de lourdes répercussions pour sa famille. Il était le seul soutien d’un foyer déjà frappé par la précarité : deux fils, Hani et Sarah, tous deux en situation de handicap ; une fille veuve ; et Hanan elle-même.
«Il faisait tout», dit-elle. «Il réparait les choses dans la maison, allait chercher de quoi manger à pied, aidait ses fils. Maintenant, il ne peut même plus voir leurs visages».
Les journées de Zafer sont désormais remplies de silence et de peur. «Il me demande sans cesse : «Et si on doit encore fuir ? Qui m’aidera ? Qui me guidera ?»», raconte Hanan. «Il me dit : «Laisse-moi derrière, mais pas Hani et Sarah. Assure-toi qu’ils soient en sécurité. C’est tout ce que je veux»».
Parfois, il s’assied près de la fenêtre et lui demande de lui décrire la rue – les passants, le ciel, les arbres. «Il veut se rappeler à quoi ressemble le monde», dit-elle, la voix tremblante. «Mais plus que tout, c’est de voir nos enfants qui lui manque».
«Il ne cesse de demander : «Quand la frontière rouvrira-t-elle ? Peut-être que je peux encore partir ?»», poursuit Hanan. «Mais au fond, nous savons tous les deux qu’il n’y a rien qui nous attende de l’autre côté. Il ne s’agit pas seulement de soins. Il s’agit de dignité – et elle nous est arrachée, jour après jour».

Des Palestiniens pleurent la mort de leurs proches à l’hôpital Al-Najjar, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 19 décembre 2023.
«Tout ce que je veux, c’est quitter Gaza avant qu’il ne soit trop tard»
Depuis six mois, Ata Ahmed (pseudonyme), 19 ans, est allongé sur le dos dans une tente, paralysé à partir de la taille. Sa vie a basculé en un instant, le 12 septembre 2024, lorsqu’une frappe aérienne israélienne a touché une maison voisine dans le quartier de Shuja’iyya, à Gaza. Des éclats d’obus lui ont transpercé la colonne vertébrale, causant des lésions irréversibles et une longue série de complications. Il a subi plusieurs opérations depuis – mais les médecins disent avoir fait tout ce qu’ils pouvaient.
«Chaque jour, j’ai l’impression que mon état empire», confie Ata à +972. «J’ai demandé une autorisation pour être soigné à l’étranger il y a plus d’un mois ; je ne peux plus attendre. Tout ce que je souhaite, c’est quitter Gaza et recevoir un traitement adéquat avant qu’il ne soit trop tard. Le cessez-le-feu m’avait redonné espoir, mais maintenant, j’ai l’impression que tout est bloqué».
Ata n’est qu’un parmi près de 35 000 Palestiniens blessés ou atteints de maladies chroniques à Gaza, actuellement bloqués sur des listes d’attente pour une évacuation médicale. Avec des hôpitaux paralysés par les bombardements répétés, des pénuries critiques et l’effondrement total des infrastructures de santé, des milliers de personnes sont privées d’un accès à des soins vitaux. Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 40% des personnes ayant demandé un traitement à l’étranger depuis le début de la guerre sont mortes en attendant – victimes des frontières fermées, d’un système d’aiguillage défaillant et d’un système de santé qui ne fonctionne plus.
Au complexe médical Nasser de Khan Younis, l’un des derniers établissements encore partiellement fonctionnels dans le sud de Gaza, Umm Saeed Ghabaeen, 81 ans, s’adosse à une chaise en plastique, visiblement épuisée, alors qu’une nouvelle séance de dialyse débute. Depuis trois ans, elle lutte contre une insuffisance rénale et dépend d’un traitement régulier pour survivre. Mais depuis le début de la guerre, son état s’est fortement dégradé. Les déplacements forcés, les graves pénuries de médicaments et même le manque d’eau potable mettent constamment sa vie en danger.
«Depuis que nous avons fui notre maison, tout a changé», dit-elle. «Les séances sont plus courtes. Les machines sont moins nombreuses. Les soins sont moins bons. Et je me sens de plus en plus fatiguée chaque jour».
Avec seulement quelques unités de dialyse encore en service dans le sud, les hôpitaux ont dû réduire le nombre de séances hebdomadaires et en raccourcir la durée – un compromis dangereux, en particulier pour les patients âgés. Les médecins alertent que ces ajustements pourraient entraîner une vague de décès évitables.
«On est poussés à bout», dit Ghabaeen. «Certains jours, je me demande si je survivrai jusqu’à la prochaine séance».
Traduction: Alain Marshal
- Source : +972