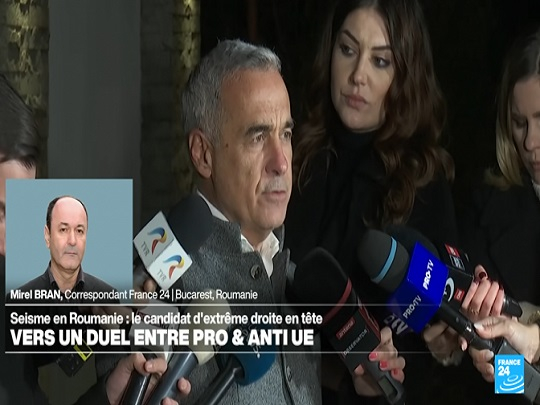Les banques centrales au service de l’oligarchie financière

Depuis la crise financière de 2008, les différentes banques centrales des grandes zones économiques se sont lancées dans des programmes de rachats d’actifs dans le but de peser à la baisse sur les taux de la dette souveraine, de relancer le crédit à l’économie par un apport de liquidités, et de relancer l’inflation, avec pour la BCE et la FED, un objectif officiel de 2%.
Dans ce but, la FED a initié plusieurs programmes de rachat d’obligations souveraines, les Quantitatives Easing, pour un montant à ce jour de plus de 4000 milliards de dollars. Ces programmes ont permis de faire pression à la baisse sur les taux longs des obligations américaines mais également d’évacuer hors du système financier une partie des créances pourries à l’origine de la crise des « subprimes », qui ont pu être rachetées par la réserve fédérale sur le marché secondaire. Ainsi, le bilan de la FED a gonflé pour atteindre en juin 2015 presque 4500 milliards de dollars, répartis entre 2460 milliards d’emprunts d’état et 1740 milliards de prêts immobiliers hypothécaires, des créances « pourries »[1].
De 3,8% en décembre 2009, les obligations à 10 ans du trésor américain sont passées à un rendement de 2,2% en décembre 2015. Cependant, au niveau du taux de croissance de l’économie, les effets des QE semblent avoir été très limités. Après la récession de 2009, le taux de croissance du PIB américain a été de 3% en 2010, 1,8% en 2011, 2,8% en 2012 et 2,4% en 2014, il peine ainsi à retrouver ses niveaux d’avant crise. Pour mémoire, il était de 2,8% en 2006 et de 3,2% en 2005[2]…
Ainsi, il paraît très difficile d’affirmer que la politique d’assouplissement monétaire destinée à relancer le crédit ait eu une influence sur l’économie réelle telle que mesurée par le taux de croissance du PIB. Un autre indicateur a cependant été mis en avant pour établir le « succès » de cette politique, le taux de chômage. Il a touché un plus bas à 4,9% en janvier 2016 selon les données du BLS alors qu’il dépassait les 10% à l’automne 2009[3]. Cette baisse spectaculaire du taux de chômage officiel a été interprétée comme le résultat de la politique d’assouplissement de la FED destinée à relancer le crédit et l’activité économique. Cependant, comme nous l’avons vu plus haut, en l’absence de véritable reprise économique, cette interprétation semble contrefaite. Ce chiffre officiel est ainsi à mettre en relation avec la baisse continue de la population active aux États-Unis, c’est à dire avec le nombre de personnes participant effectivement au marché de l’emploi. Le taux de la population active, compris avant la crise entre 66 et 67% a ainsi chuté depuis 2008 pour atteindre 62% en 2015, ce qui signifie que des millions d’Américains ont disparus des statistiques car ils n’effectuent plus de démarches positives de recherche d’emploi. Calculé sur la base du taux de population active avant crise, le taux de chômage se monterait ainsi à 10,5 % en 2015[4]. Certains calculs prenant une définition plus large du chômage et incluant les temps partiels subis, à partir d’une heure de travail déclaré par mois, arrivent ainsi à un taux de chômage réel supérieur à 20%[5]. Michael Snyder, arrive à la conclusion statistique que, dans un foyer américain sur cinq, plus personne ne travaille[6].
La population américaine a ainsi connu une paupérisation massive depuis 2008, que l’on peut observer dans le nombre de bénéficiaires du programme fédéral alimentaire, qui se maintient depuis six ans aux dessus des 44 millions de bénéficiaires contre 27 millions avant la crise, comme le montre le graphique ci-dessous.

En conséquence, les revenus et la taille de la classe moyenne ne cessent de diminuer. Cette dernière représentait 54,2% de la population des États-Unis en 1996 contre 50,6% en 2012[7]. Elle captait 48,5 % des revenus en 1996 contre 43,7% aujourd’hui. Le revenu médian au sein de la classe moyenne a baissé de 77.898 dollars en 1999 à 72.919 dollars en 2014…
A qui profitent les politiques d’assouplissement quantitatif des banques centrales ?
L’apport de liquidités dans le système financier par le biais des rachats d’actifs s’est traduit essentiellement par une inflation du prix des actifs financiers. Le principal indice action américain, le Standard and Poors, est ainsi passé d’un plus bas à 680 points début 2009 à plus de 2000 points en avril 2016, soit une multiplication par trois du cours des actions. Ainsi, comme l’ont analysé certains intervenants des marchés, les politiques d’assouplissement monétaires mises en place par la FED, mais également par les autres banques centrales majeures, ont avant tout comme effet et pour fonction de soutenir et de doper les cours des actifs financiers[8]. A contrario de leur mandat officiel et de leurs déclarations de politique économique, leur principale préoccupation reste ainsi de soutenir les cours des actifs et de créer un « effet richesse » qui profite exclusivement aux détenteurs du capital financier.
Aux Etats-Unis, suite à la mise en place des premiers programmes de Quantitative Easing entre 2009 et 2012, les 1% des ménages les plus riches ont ainsi captés 95% du total des hausses de revenus et ont retrouvé en trois ans seulement leur niveau de revenu d’avant la crise[9]…
La BoJ, Banque centrale of Japan, a étendu récemment son programme de rachat d’actifs aux actions, alors que ses précédents programmes de rachat de dette souveraine n’ont eu aucun impact sur l’économie réelle. En 2015, la croissance du PIB a été de 0,90% après avoir baissé de -0,10% en 2014. Commencé en 2001, le rachat de titres par la BoJ sur les marchés n’a cessé de gonfler depuis afin de soutenir les cours des actifs. Là encore le prétexte est de sortir le pays de la « déflation ». En avril 2013, la BoJ a ainsi annoncé une nouvelle augmentation de son programme de rachats d’actifs pour le porter à 575 milliards d’euros par ans ainsi qu’une extension des actifs financiers visés, notamment par le rachat de fonds indiciels cotés, les ETF. Le programme deviendra effectif à l’automne 2014, ce qui se traduira par une hausse de l’indice action Nikkei qui est passé de 9000 points en octobre 2012, à plus de 16000 points en octobre 2014 pour atteindre un sommet à plus de 20 000 points à l’été 2015, cela alors que la dette publique dépasse les 240% du PIB et que la croissance reste anémique…
En Europe, la BCE, malgré l’échec de son précédent programme d’assouplissement monétaire à relancer l’inflation et la croissance en zone euro, cette dernière était de 0,9% en 2014 et l’inflation de 0,5% en 2014, a étendu son programme d’assouplissement quantitatif au rachat de titres obligataires privés, en mars 2016. Les obligations visées appartiennent aux obligations d’entreprises de la zone euro notées « investment grade » et vise 25% du marché de cette catégorie d’actifs, ce qui porterait le programme à 400 milliards d’euros. Comme tous les programmes de rachats d’actifs précédents, cette annonce s’est traduite par une baisse des taux obligataires et une hausse de la valeur des titres concernés. Toutefois, face à l’échec des programmes menés jusqu’ici à relancer l’inflation, de nombreux investisseurs estiment que la BCE pourrait se lancer dans un programme de rachat d’actions et suivre la voie tracée par la BoJ, bien que là encore, les rachats opérés par cette dernière ne se soient jamais traduits par une relance de l’inflation…
Ainsi, selon BSI economics[10], le véritable objectif de ces programmes consiste à faire gonfler le prix des actifs afin de créer un « effet richesse » à destination des détenteurs d’actifs financiers. La baisse du coût de financement des entreprises européennes notées « investment grade » favoriserait ainsi leurs programmes de rachats d’actions à destination de leurs actionnaires. Selon BSI economics :
« Les entreprises européennes seront ainsi incitées à s’endetter dans le but de redistribuer une partie de cet emprunt à leurs actionnaires. »
Pour Joseph Gagnon, du Peterson Institute for International Economics, le programme de rachat d’actions de la BoJ répond également à l’objectif de « faire monter les cours des actions et à encourager la consommation et l’investissement par le biais de l’enrichissement des ménages et de la baisse du coût du capital. [11]»
L’effet richesse et l’inflation poursuivis par ces programmes ne visent ainsi pas les classes moyennes et l’économie réelle mais les détenteurs des actifs financiers, c’est à dire l’oligarchie mondiale qui voit son capital financier exploser à chaque nouvelle mesure des banques centrales pendant que les classes moyennes se paupérisent chaque jour un peu plus sous l’effet des politiques d’austérité, des mesures structurelles et de la modération salariale, qui sont justifiées par la théorie du « choc d’offre » censée relancer la croissance économique par une augmentation des marges des entreprises et une reprise de l’investissement, mais qui se traduit concrètement par des politiques de redistribution en faveur des actionnaires et des détenteurs du capital financier.
La boucle est ainsi bouclée…
Notes:
[1]États-Unis : le bilan de la Fed est clair, Contrepoints, juillet 2015
[3]Le taux de chômage dépasse les 10% aux Etats-Unis, Le Figaro, novembre 2009
[4]Quel est le vrai taux de chômage aux Etats-Unis ?, Economie matin, septembre 2015
[5]Les chiffres truqués du chômage aux Etats Unis, Central Charts,
[6]In 1 Out Of Every 5 American Families, Nobody Has A Job, The Economic Collapse, avril 2016
[7]La classe moyenne disparaît aux Etats-Unis, beaucoup moins en France, La Tribune, février 2016
[8]La minute de Delamarche, les banques centrales se foutent de l’économie réelle, BFM Business, mai 2016
[9]Etats-Unis : en trois ans, les 1% les plus riches ont capté 95% des hausses de revenus, Slate, septembre 2013
[10]Les enjeux des rachats de dette privée par la BCE, BSI Economics, avril 2016
[11]Des achats d’actions par la BCE et la BoJ jugés crédibles, Les échos, mai 2016
Guillaume Borel est l’auteur de l’ouvrage Le travail, histoire d’une idéologie, qui vient de paraître aux Éditions Utopia.
- Source : Arrêt Sur Info